Derniers sujets
Sujets similaires
freedom and justice to Palestine

ARCHITOUS HOUR
Qui est en ligne ?
Il y a en tout 65 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 65 Invités Aucun
Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 126 le Jeu 8 Sep 2011 - 20:38
la dualité: bonheur/malheur
« Lorsque le malheur touche l’homme il est plein d’impatience;et lorsque le bonheur l’atteint, il devient insolent.
bonheur naît du malheur, le malheur est caché au sein du bonheur
On n'est jamais si malheureux qu'on croit ni si heureux qu'on avait espéré.
Le vrai bonheur coûte peu; s'il est cher, il n'est pas d'une bonne espèce.
villes et risques urbains
4 participants
 villes et risques urbains
villes et risques urbains
salut ..
-- Risque urbain et risque territorialisé.--
lemoudaa charaf eddin
email tchat04325@yahoo.fr
.
.
La meilleure politique est inutile si elle reste lettre morte. Sa faisabilité est une question
aussi importante que ses objectifs. C'est sous cet angle, qui fait la part belle à l'analyse
des représentations collectives, des rumeurs et des rapports de force, qu'est abordée
l'alerte en milieu urbain.
On connaît aujourd'hui une inflation des discours autour de la peur collective à travers
l'évocation de risques naturels et technologiques ou de risques sanitaires. Ils font écho à
d'autres peurs plus générales : terrorisme, délinquance, etc. De nombreuses questions
peuvent être posées sur le hiatus entre peur et danger réel. Ainsi que signifient dans nos
sociétés tous ces objets et procédures supposés écarter les dangers ? Par ailleurs, nos
sociétés semblent développer une sorte d'"addiction à la peur", dans un univers aseptisé.
À l'inverse, apparaissent des attitudes de conjuration, permettant aux populations de
domestiquer ou de refouler l'angoisse : "domestication" des catastrophes naturelles lors
du maintien de l'habitat en zone dangereuse, risques nucléaires. Certains dangers sont
sous-estimés, d'autres surestimés. Tout cela aboutit à des procédures tout à fait
inadaptées lorsque l'aléa se réalise.
L'environnement n'existe que dans la mesure où il "environne" l'homme. Ce que les gens
perçoivent de leur environnement donne donc lieu à un travail de négociation et de
réinterprétation, qu'il convient d'intégrer en permanence aux procédures d'alerte si l'on
veut que ces dernières aient un minimum d'efficacité. C'est la question de l'acceptabilité
sociale du risque qui est en jeu ici.
Terrains
Deux grands cas : agglomération de Mexico, Nouvelle-Orléans et delta du Mississipi.
Terrains annexes : Bhopal, Paris, Seattle, Sidney, Tchernobyl, Toulouse
*********************************
Je veux que vous pour participer et pour me fournir de plus amples renseignements..
merci..
-- Risque urbain et risque territorialisé.--
lemoudaa charaf eddin
email tchat04325@yahoo.fr
.
.
La meilleure politique est inutile si elle reste lettre morte. Sa faisabilité est une question
aussi importante que ses objectifs. C'est sous cet angle, qui fait la part belle à l'analyse
des représentations collectives, des rumeurs et des rapports de force, qu'est abordée
l'alerte en milieu urbain.
On connaît aujourd'hui une inflation des discours autour de la peur collective à travers
l'évocation de risques naturels et technologiques ou de risques sanitaires. Ils font écho à
d'autres peurs plus générales : terrorisme, délinquance, etc. De nombreuses questions
peuvent être posées sur le hiatus entre peur et danger réel. Ainsi que signifient dans nos
sociétés tous ces objets et procédures supposés écarter les dangers ? Par ailleurs, nos
sociétés semblent développer une sorte d'"addiction à la peur", dans un univers aseptisé.
À l'inverse, apparaissent des attitudes de conjuration, permettant aux populations de
domestiquer ou de refouler l'angoisse : "domestication" des catastrophes naturelles lors
du maintien de l'habitat en zone dangereuse, risques nucléaires. Certains dangers sont
sous-estimés, d'autres surestimés. Tout cela aboutit à des procédures tout à fait
inadaptées lorsque l'aléa se réalise.
L'environnement n'existe que dans la mesure où il "environne" l'homme. Ce que les gens
perçoivent de leur environnement donne donc lieu à un travail de négociation et de
réinterprétation, qu'il convient d'intégrer en permanence aux procédures d'alerte si l'on
veut que ces dernières aient un minimum d'efficacité. C'est la question de l'acceptabilité
sociale du risque qui est en jeu ici.
Terrains
Deux grands cas : agglomération de Mexico, Nouvelle-Orléans et delta du Mississipi.
Terrains annexes : Bhopal, Paris, Seattle, Sidney, Tchernobyl, Toulouse
*********************************
Je veux que vous pour participer et pour me fournir de plus amples renseignements..
merci..
charafsoft-
 Messages : 1
Messages : 1
Points : 3
Réputation : 0
Age : 37
Localisation : souk naamane
 La gestion territoriale des risques urbains,
La gestion territoriale des risques urbains,
j'ai essayé de partager quelques documents que j'ai trouvé sur le thème concerné par le concours de magister Constantine "villes et risques urbain"
1La gestion territoriale des risques urbains,
un outil de développement durable ?
Penser les risques urbains
Les cours de sociologie urbaine relatent « la ville inquiète », « la ville incertaine »,
« la ville ambivalente». Violences urbaines et pollutions environnementales semblent s’y
côtoyer, mais aussi quartiers exclus et nuisances sonores ; mesure de qualité de l’air et
saturation sociale des espaces publics ; montée du chômage, du communautarisme et
dysfonctionnements des services urbains en réseau. La liste est longue où les politiques de
la Ville et celles de développement durable rencontrent la question des risques
environnementaux, sanitaires ou industriels. Cette concentration d’inégalités et/ou de
nuisances, conséquence par accumulation historique des enjeux urbains de la ville
industrielle du 19ème siècle, est flagrante dans le cas français, et plus scandalisante encore
dans les métropoles des pays en voie de développement.
Le milieu urbain exacerbe les risques. Leur présence est inéluctable, ce qui ne
signifie pas que la ville soit « délétère »1, c'est-à-dire insalubre et nuisible. La ville induit
des risques, mais ne s’y réduit pas. Le modèle de la ville tentaculaire, globale, concentrant
activités, emplois et populations se diffuse universellement2. D’une part, la ville fait partie
intégrante d’un réseau territorial complexe, générateur inhérent de risques, et, d’autre part,
elle peut être atteinte dans son organisation sociale, économique et politique par
l’occurrence d’un danger, interne comme externe, naturel ou industriel. Le risque urbain
est défini comme l'ensemble des risques liés au territoire de la ville, c'est-à-dire à la fois les
« risques manufacturés » (BECK, 2003) et les risques pouvant survenir sur l’espace urbain.
Ceux-ci ne se limitent pas aux risques naturels et technologiques. L’espace urbain
juxtapose à la fois des risques territorialisés, inscrits dans un espace délimité (incendie,
éboulement) mais aussi des risques de réseau touchant un nombre indéfini d’acteurs (risque
aérien, ferroviaire, informatique) ; et enfin, des risques diffus, dont l’espace d’impact ne
peut être circoncit tels que la pollution de l’air ou la légionellose3.
Fabriquer la ville durable est aujourd’hui, d’une part, un enjeu d’innovation
administrative et politique et, d’autre part, un ensemble d’actions concrètes et
d’expériences menées. En tant que danger ou phénomène néfaste, plus ou moins prévisible,
ne dépendant pas exclusivement de la volonté des parties et pouvant causer dégradation,
perte ou tout autre dommage4, le risque se définit par cet aléatoire, cette probabilité de
l’accident5. L’espace d’impact, quand il peut être prévu, correspond rarement à un
périmètre administratif délimité. La gestion des risques, tout comme les politiques de
développement durable, sont un régime du contradictoire et de l’incertain. L’enjeu de
l’action publique est de s’adapter à cette contingence, à cette complexité postmoderne
(ASCHER, 2001).
L’organisation administrative locale de la gestion des risques
Notre étude porte particulièrement sur l’action publique municipale et
intercommunale : la Communauté urbaine de Nantes Métropole, « mission Risques et
Pollutions » sous la direction de M. Joël GARREAU ; la Ville de Lyon et la communauté
urbaine du Grand Lyon, respectivement « mission Sécurité et Prévention » et « mission
Risques Majeurs », sous la direction respective de MM. PASINI et DELACRETAZ.
1 Expression de Sabine BARLES dans son ouvrage La Ville délétère, Coll. Milieux, Ed. Champ Vallon, Paris, 1999.
2 Sur le cas particulier des villes européennes, lire LE GALES Patrick, Le retour des villes européennes : sociétés
urbaines, mondialisation, gouvernement et gouvernance, Presses de Sciences Po, Paris, 2003.
3 GALLAND Jean-Pierre, Calculer, gérer, réduire les risques : des actions disjointes ? Annales des Ponts et Chaussées,
n°105, janvier-mars 2003.
4 Petit Larousse 2002
5 Nous nous distancions en ce sens des définitions des géographes qui voient dans le risque une représentation sociale du
danger autour du quel un groupe social se mobilise.
2
A partir des données recueillies sur ces terrains6, nous allons :
1) présenter les enjeux communs à ces deux politiques intersectorielles :
2) voir comment les services locaux de gestion des risques y répondent
3) et d’essayer de comprendre les liens entre l’organisation publique du développement
durable et de la gestion de risque.
Nous émettons l’hypothèse que certains enjeux et certains paradoxes propres aux
politiques intersectorielles se retrouvent dans l’action publique de développement durable
et de gestion des risques. Une question focus en ressort : Comment penser la durabilité face
à l’instantanée (gestion des crises) et à l’incertain (aléa) contemporains ?
I- Des enjeux communs
Des quartiers de cumuls
La ville trop exposée aux risques n’est pas durable. Dans l’espace territorial français, des
quartiers fragiles et vulnérables existent aux abords des grandes villes. Ces espaces de
marginalisation cumulée concentrent chômage, difficulté d’intégration, déscolarisation,
échecs des politiques de prévention sanitaire et sociale... Face aux pressions financières
inflationnistes du foncier, il n’est pas rare que ces quartiers soient implantés sur des
territoires à risques :
- risques industriels liés d’une part à la localisation périphérique à proximité des
grands axes de communication (nuisances sonores, qualité de l’air, transports de
matières dangereuses, ligne à haute tension.. ; exemple :Val d’Argent,Argenteuil),
mais aussi à la proximité de zones d’activités et donc d’emploi (risques industriels
de tout genre : fuite toxique, explosion, écoulement… ; exemple : explosion de
l’usine AZF, Toulouse);
- risques naturels liés notamment à une localisation en zones inondables, sur des sols
instables, sur des cavités (exemple : Balmes lyonnaises, Lyon) ;
- dégradation des services en réseaux augmentant problème de salubrité et d’hygiène
publique, ceci allant des services d’eaux usées à réseaux électriques fournissant
lumière et chauffage.
Selon Jacques THEYS, « le cumul des risques environnementaux et industriels, mais aussi
urbains et sociaux dans des quartiers dépotoirs » doit interpeller les politiques de
développement durable afin de s’interroger sur la durabilité des situations en proie à une
vulnérabilisation sociale et urbaine grandissante7.
1-1 Définitions : proximité et limites de l’analyse comparative des politiques de
développement durable/gestion des risques en terme d’action publique locale
L’utilisation inflationniste des appellations de « développement durable » et
« gestion des risques » appellent au préalable un effort de définitions.
Le risque est un terme polysémique, fondamentalement philosophique et politique.
Communément, le risque est l’éventualité, la probabilité de l’accident en tant que situation
dangereuse susceptible d'entraîner des pertes. Une lecture étymologique montre que le mot
« risque » provient du latin resecare8, qui signifie couper le cours des choses, l’ordre
établi, le quotidien par la survenance imprévisible d’un danger ; et du grec byzantin
6 A ce stade d’avancement, je n’ai analysé que des services administratifs de gestion des risques et non des missions de
développement durable. Je me base donc, d’une part, sur les conclusions du mémoire de DEA Mutations Urbaines et
Gouvernance Territoriale « les capacités de régulation d’une gestion transversale et multipartenariale des risques dans
l’action publique locale » et, d’autre part, sur la problématique de travail de thèse engagée sur « la structuration
administrative des services intercommunaux de gestion des risques ».
7 THEYS L’approche territoriale du " développement durable ", condition d’une prise en compte de sa dimension
sociale Par Jacques Theys, Publié le 23/09/2002 ; site de la revue électronique Développement Durable et Territoires,
www.revue-ddt.org/dossier001/D001_A05.htm
8 DUBOIS Jean, MITTERAND Henri et DAUZAT Albert, Dictionnaire étymologique, Larousse, Paris, 2001.
3
rhizikon « hasard »9 ou plus précisément le solde gagné par chance par un soldat de
fortune, ce qui introduit la notion de gain potentiel. En effet, Le Larousse (1992) définit le
risque par l’attente de conditions de succès, « en assumant la responsabilité de quelque
chose, d’une entreprise » c'est-à-dire osé, licencieux. Nous nous situons tout de suite dans
le débat autour d’un risque valorisable ou non. Au coeur de cette ubiquité, le risque est ici
entendu comme un danger face auquel l’action publique se mobilise, qui l’appréhende
globalement comme une contrainte de gouvernement. Le terme de risque est mobilisé dans
des situations où se croisent un aléa, c'est-à-dire un danger, et des enjeux humains,
économiques, naturels, patrimoniaux… La gestion des risques sera l’action de prévenir les
dangers internes et externes, d’assurer la sécurité du territoire, ainsi que celle des citoyens,
afin de contrôler le fonctionnement urbain et d’en réduire les vulnérabilités.
Le développement durable serait, selon la définition du rapport BRUNTLAND
(1987), « agir de manière à satisfaire les besoins des générations présentes sans
compromettre la possibilité des générations futures de satisfaire les leurs». C’est le passage
dans les priorités d’action, publique dans notre cas, de la rentabilité économique à court
terme à une efficacité allocative à long terme ; de la recherche de l’égalité sociale à celle
d’une efficacité distributive ; et de la stricte conservation des richesses à une équité
environnementale. Le développement durable a deux histoires : la première explique
comment se réalise le prolongement logique des théories écologistes dans les réflexions sur
le développement (ZACCA, 2002) ; la seconde privilégie la notion de rupture,
d’innovation du concept et sa portée politique (RIST, 1996). Selon Jacques THEYS, la
première définition est un peu réductrice, car le rapport BRUNTLAND est une véritable
rupture historique. Le développement durable est représenté dans sa forme explicative de
stratégie des « Trois E ». Les projets doivent pouvoir prendre en compte les facteurs
environnementaux (préservation des ressources à long terme, prévention des risques), les
facteurs économiques (efficacité et maintien de la croissance) et les facteurs éthiques ou
sociaux (principe d'équité sociale, de non-ségrégation)
L’histoire du développement économique, social et politique crée des défis
communs entre politique de développement durable et gestion des risques. Comment
expliquer le rapprochement opéré par les théoriciens et les gestionnaires publics entre ces
deux définitions ?
Les conséquences de la croissance démographique et économique sur
l'environnement, l'essor productif et la diversité des besoins (agricoles, industriels,
énergétiques, hydrauliques, technologiques) pèsent de plus en plus sur l'exploitation des
ressources naturelles : elles se raréfient, ce qui vulnérabilise les territoires. L'augmentation
des demandes s'accompagne d'une exploitation accélérée de l'environnement. Les modes
de production et de consommation de la société industrielle et post-industrielle portent
atteinte aux patrimoines collectifs, aux grands équilibres de l’écosystème, génèrent des
comportements de gaspillages. Ils menacent aussi les conditions mêmes de la vie en
augmentant l’occurrence de risques. Le changement d'attitude vers une prise en compte
raisonnée de l’environnement et des données culturelles dans l’économie résulte d'une
nouvelle appréhension des "externalités". Le risque apparaît comme le mal social global
qui déstabilise l’activité économique, complique l’exercice de l’activité politique et
fragilise la confiance sociale entre citoyens et institutions10. Le paradoxe est flagrant entre,
d’une part, progression du sentiment d’insécurité et, d’autre part, amélioration de la
sécurité et de l’hygiène par les progrès des sciences et des savoir-faire. Une étude en terme
de rationalité expliquerait ce point, mais ce n’est pas notre sujet.
Le risque apparaît alors comme un système de pensée, un nouvel axe
d’appréhension des externalités des systèmes (économiques, territoriaux) de production et
9 Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, Paris, 2002.
10 NOIVILLE Christine, Du bon gouvernement des risques, Les voies du Droit, PUF, Paris, 2003.
4
d’exploitation, et aussi comme une ressource politique, une catégorie d’action publique. La
fin de la foi scientiste dans le risque zéro interroge les nouveaux modes de gouvernement.
En 1993, le Ministère de l’Equipement fait paraître les actes de son deuxième séminaire
« sécurité-risques-insécurité »11 dans l’ouvrage Les insécurités urbaines. Le discours tenu
encourage une gestion des risques transdisciplinaire et globale pour répondre à
l’omniprésence de la probabilité de dysfonctionnements. L’administration des risques12 est
un processus d’amont en aval, englobant les phases de prévision et de prévention, de
maîtrise et de gestion de crises, de retours d’expériences et d’évaluation.
L’objet d’une politique publique est la résolution de problèmes par l’élaboration
d’un système d’action concret au sein duquel des acteurs vont mobiliser des ressources
diverses au service de stratégies de pouvoir13. On ne parle donc pas aujourd'hui de
« politique publique du risque » mais les domaines d’action publique sectoriels - risques
naturels et risques technologiques principalement - sont nombreux. Si les politiques de
développement durable et de gestion des risques ont des enjeux communs à relever, reste à
se demander, à l’instar des réflexions soulevées par Jacques THEYS, si la surabondance de
politiques transversales convergentes aide à la définition d’objectifs clairs et à l’élaboration
d’actions spécifiques ?
1-2 Agir sur l’incertain
Comme nous l’avons vu, les politiques publiques de développement durable et de
gestion des risques cherchent la mise en place à solutionner les conflits d’objectifs posés à
l’action publique. Les politiques intersectorielles doivent gère l’emboîtement et la
coordination des compétences juridiques croisées des collectivités. En effet, les défis de la
gouvernance complexe peuvent être résumés :
- l’accumulation de territoires (géographique, institutionnel, vécu). Questionner les
rapports sensibles et pragmatiques portés aux territoires incite les politiques publiques à se
situer dans un espace choisi, ou du moins décidé et donc qui doit pouvoir être argumenté,
expliqué. Plutôt que de proposer des réponses, cette intervention posera des pistes de
questionnement sur le rôle que peuvent jouer les intercommunalités dans ce débat.
- la superposition des systèmes d’acteurs. Le processus de métropolisation, la
régionalisation dans le cadre de l’élargissement européen, mais aussi le redémarrage des
dynamiques de décentralisation ainsi que les revendications des collectivités locales
bouleversent les frontières traditionnelles inter et intra-étatiques. Ces mouvements de
recomposition des territoires institutionnels permettent à l’action publique locale de
repenser son organisation politique, administrative et juridique.
- l’empilement de différentes temporalités d’action : entre prévention et anticipation,
maîtrise et opérationnalité, appréhension de l’urgence et travail de mémoire, quelles
peuvent être les formes acceptables permettant de faire travailler ces domaines ensemble ?
L’organisation de nouveaux outils, voire de modèles, de gestion, de régulation et de
coordination sont au coeur de nos interrogations, mais aussi de nos observations antérieures
lors du travail de recherche en DEA. La transversalité dans la gestion locale et
multiterritoriale présente-t-elle une approche renouvelée de l’action publique ? Permet-elle
de résoudre les contradictions spatio-temporelles ? On entend par « transversalité » la prise
11 Les Insécurités Urbaines, actes du séminaire II « sécurité-risques-insécurité », Ed. STU, Paris, 1991.
12 L’administration des risques est le terme ancien de management des risques, peu utilisé en France pour ses
connotations bureaucratiques, dérives communes du terme wébérien, mais largement répandu dans le management en
Amérique du Nord. Nous l’utilisons ici en synonyme de « gestion ».
13 Selon la définition de Michel CROZIER, c’est un « espace d’échanges finalisé entre acteurs, constitutif de relations de
pouvoir en fonction de ressources mobilisées » Les politiques publiques constituent un cadre normatif d’action, un
ensemble de mesures concrètes, comme un financement, des textes de loi ou un personnel administratif et politique
Ensuite, une politique publique est l’expression de la puissance publique. Il y a toujours une notion de décision ou
d’allocation de ressources, de nature plus ou moins autoritaire, basée sur le principe de relations dissymétriques entre
l’Etat et les citoyens. Enfin, elles constituent un ordre local, instaurant une régulation des conflits entre les administrés,
image d’une construction d’un rapport au monde, d’un référentiel selon Pierre MULLER.
5
en compte de la connexité des disciplines, des territoires, des acteurs en tant que nécessité
pragmatique de gestion et exigence procédurale de réflexivité14.
Mais ne doit-on pas se ranger, avec ses détracteurs, à penser qu’une approche
transversale n’invente pas d’outils simples, synthétiques et synthétisants, mais au contraire
accroît la sectorisation en multipliant les domaines d’intervention ? Ce thème de
transversalité n’est-il qu’un outil « à la mode » tentant de résoudre en vain les complexités
inhérentes à une réalité culturelle, sociale, économique ou politique ? Ces questions ont
leur importance scientifique et théorique.
- La coopération est désormais résolument multiniveaux. Les politiques publiques sont
largement territorialisées, c’est-à-dire que les territoires sont les cadres de l’action
publique et des coopérations entre acteurs15. Les négociations sont ponctuelles,
réparties par site. Une analyse cloisonnée par territoires tend à provoquer des
dysfonctionnements en cascade.
- Les études d’acteurs sont souvent sectorisées. Les logiques territoriales, les intérêts
particuliers, les stratégies d’ensemble et les finalités d’action sont rarement interreliés.
Si l’étude paraît théorique, les conséquences sont pourtant visibles au quotidien.
- Les temporalités de la gestion des risques sont strictement séparées : un temps pour la
gestion, un temps pour la crise et un temps pour les bilans. Ce cloisonnement masque
la nécessaire prise en compte du processus général de décision. Les choix des acteurs et
leurs conséquences ne peuvent être isolés dans le temps.
Conclusion
La volonté d’une étude comparative de la genèse des structurations des services
administratifs de développement durable et de gestion des risques permettrait d’étudier les
différences de prise en compte des enjeux, les outils de solution apportés et les orientations
choisies. Le développement durable ou la gestion dans risques jouent-t-ils ce double rôle,
d’une part, de catalyseur de transversalité des domaines publics d’intervention et, d’autre
part, d’illusion motrice permettant l’innovation des pratiques administratives ?
II – L’organisation des services administratifs de gestion des risques dans les
collectivités locales
Les expérimentations de gestion transversale
La recomposition des territoires institutionnels permet d’appréhender le
développement durable dans de nouveaux espaces géographiques, politiques, administratifs
et juridiques. En France, certaines municipalités et EPCI (Etablissement Public de
Coopération Intercommunale) se réapproprient l’organisation mutualisée des services
publics administratifs. En s’intéressant à leur validité institutionnelle, notre but est de
comprendre en quoi il y a, ou non, avancée théorique sur la transversalité dans l’action
publique locale et en quoi il y a, ou non, expérimentations concrètes.
2.1 Des territoires transcalaires
Cette expression utilisée par Valérie NOVEMBER dans Les territoires du risque,
signifie, qu’en plus de croiser des territoires géographiques différents, la gestion des
risques engage des espaces politiques et vécus disparates, voire discordants.
L’auteur invite à prendre en compte la connexité entre territoire physique et risques.
En constante évolution, le territoire subit de plein fouet les dynamiques aléatoires des
14 La transversalité peut être appréhendée comme une réponse technique et scientifique de régulation à un problème
donné, une réponse de gestion face à de nouveaux objectifs propres à la gestion des risques, une réponse de flexibilité
face à un environnement instable. Elle se caractérise par ses caractères de réflexivité, d’innovation et de coopération.
15 Il serait d’ailleurs pertinent d’interroger sur la validité normative ou non des territoires comme espace a priori de
résolution, d’expérimentation, de coopération…
6
risques. Bien que certains dangers se caractérisent par une absence de limites spatiales, les
accidents surviennent néanmoins sur des espaces concrets. La gestion des risques, au delà
des connaissances techniques, statistiques, météorologiques ou géomorphologiques, exige
une sensibilité, une attention portée aux évolution territoriales. Ghislaine MAGNE,
responsable de la direction « Sécurité civile et Sécurité du public » explique d’ailleurs :
« On se doit, et ça c’est ma conviction, de connaître les entreprises, le tissu industriel de
petites et moyennes entreprises également (…) Nous sommes là aussi pour faire de
l’analyse de tissu urbain. » La gestion des risques est un exercice de réceptivité des
constantes et des fractales territoriales, un rapport renouvelé au « local ». Lieu de
réalisation du lien social, d’enracinement identitaire ou de démocratie de proximité,
l’espace local offrirait des réponses adaptées, situées, « à taille humaine », atouts
recherchés, ou du moins espérés, par les politiques et les populations.
Une interrogation demeure cependant : ces territoires géographiques et vécus du
risque peuvent-ils être rendus compatibles dans un périmètre institutionnel ? Les services
administratifs révèlent un véritable manque de ressources humaines, financières et
technique, notamment dans les moyennes et les petites communes16, tout au moins leur
éparpillement. Généralement, chaque ville gère « ses » risques territoriaux isolément des
communes, sans cohérence entre les politiques de prévention et de gestion de risque. Les
responsables administratifs souhaitent une gestion supracommunale17 qui permettrait, tout
d’abord, une mutualisation des moyens, des savoirs-faire et ensuite qui rentabiliserait le
matériel, nécessaire mais onéreux et finalement rarement utilisé. Des économies d’échelle
seraient réalisées et de nouvelles capacités d'investissements seraient offertes.
Si le consensus se fait autour des potentiels bienfaits, la forme des partenariats et
l’identité transcommunale sont variables. Selon nous, le moment de l’élaboration
d’objectifs est plus important que l’attribution a priori d’un périmètre institutionnel ou
géographique. Pourtant, le fait que l’idée de regroupement communal fasse son chemin
prouve que les attentes existent.
2.2 La recherche de coopération entre niveaux décisionnels
L’administration des risques, qu’elle soit européenne, nationale ou locale, est
aujourd’hui face à plusieurs centres de décisions administratifs et plusieurs acteurs
institutionnels. Les niveaux communaux, intercommunaux, départementaux, régionaux et
nationaux sont sollicités, parfois tous de concours18. Le manque de cohérence constaté
pose un problème d’égalité et d’équité territoriales mais aussi de risque organisationnel et
d’effet domino. Michel BARDOUILLET fait l’observation suivante : « On ne peut pas
s’en sortir, il est impossible que les villes travaillent chacune pour elle alors que le
problème peut venir de chez le voisin. A partir du moment où une rivière ou un fleuve
traverse plusieurs communes, il est évident que les désordres vont toucher plusieurs
communes. » L’intervention concomitante de pôles politiques et administratifs appelle une
clarification du jeu d’acteurs.
Le jeu d’acteurs impliqués dans la gestion des risques paraît si alambiqué qu’en
dresser un tableau est en soi un pari. Nous avons procédé à l’étude de deux systèmes
d’acteurs : celui au sein de la collectivité entre les services administratifs communaux et
intercommunaux en présence. Le second comprend une quantité difficilement dénombrable
d’acteurs, dans lesquels se retrouvent principalement l’Etat, ses services déconcentrés, la
collectivité locale et la société civile.
- Au sein des services administratifs, qu’ils soient transversaux ou sectorisés, la
gestion des risques a un rôle interservice de pilotage des dossiers, un rôle de transmission
16 Livre blanc des risques majeurs dans les collectivités territoriales, document élaboré par le CNFPT et l’ENACT, 1990.
17 Dans le sens d’un pôle de communes agglomérées, pas strictement en terme d’EPCI.
18 Nous n’avons eu à aborder les implications internationales uniquement dans le cas de la transposition de la directive
européenne SEVESO. Ce simple exemple montre que l’Union européenne est aussi source de droit en matière de gestion
de risques.
7
et de coordination entre les acteurs des services administratifs d’intervention - soit les
services techniques urbains de type voirie, assainissement, déchets ou droits des sols, soit
le développement urbain comme l’aménagement du territoire, la politique de la Ville ou les
politiques d’agglomération. A la fois techniciens et experts, il est difficile de savoir si ce
rôle entre-deux est vécu comme valorisant ou non. En effet, le constat du manque de
moyens démontre le manque de reconnaissance véritable dans les organigrammes des
collectivités. Cette carence concerne non seulement les ressources humaines et techniques
mais aussi politiques et juridiques. Au-delà des revendications budgétaires, un portage
politique et une base de compétences légales sont nécessaires pour assurer le respect de la
réglementation et pour assumer les responsabilités des élus. Les responsables de services
pointent l’absence « d'élu synthèse », c'est-à-dire d’élu référent, de porte-parole, de
représentation politique. Dès lors, le maire apparaît comme le recours naturel face aux
situations de crise. Il est considéré comme l’acteur principal de la vie municipale, identifié
et repéré de tous. La préoccupation de sécurité des citoyens nécessite une présence
quotidienne, une véritable culture de la disponibilité au public. Le maire est face à un
nombre croissant de demandes, d’attentes et d’objectifs contradictoires sur le territoire de
sa commune, comme l’implantation d’entreprise ou la préservation de zones dites à risque.
Or, le manque de moyens mis à la disposition de l’aide à la décision en gestion de risques
renvoie le maire à une kyrielle de responsabilités juridiques qu’il ne semble plus pouvoir
différencier.
- Les cellules locales de gestion des risques s’inscrivent aussi dans un système
d’acteurs externe à leur collectivité. Ce système est diffus et marqué par les relations entre
le préfet et le maire. Les pénuries de moyens, de légitimité politique ou les superpositions
de compétences juridiques vont cristalliser les revendications de chacun autour d’un même
objectif : obtenir une répartition stricte des responsabilités pour garantir une unité de
commandement19. Le maire exerce son pouvoir sous le double contrôle politique, d’une
part, du conseil municipal et administratif, d’autre part, du représentant de l’Etat dans le
département. Le préfet dispose d’un pouvoir de police générale qu’il exerce ainsi dans les
mêmes domaines en cas de carence, de silence, de défaillance des maires et lorsque
l’espace menacé excède la superficie de la commune. Inscrit dans le jeu global des acteurs
nationaux et locaux, les services de gestion des risques peinent à assurer au maire une
position stable et clairement définie dans un système aux compétences juridiques et aux
responsabilités administratives et pénales désunies20. Leurs ressources apparaissent
dérisoires pour recouvrir la prévention des risques et la protection des populations au
quotidien. L’Etat, par la présence du préfet et des services déconcentrés (en grande partie :
DDE, DRIRE, DDAF et DIREN), reste garant de la sécurité des citoyens sur le territoire.
Autour de ce binôme gravite un nombre instable d’acteurs externes, publics et privés.
Or, certains mécanismes de coordination sont en crise21 et s’inscrivent dans un système
assez étanche. La force des messages médiatiques influence l’ordre d’importance, publique
et politique, des risques. Les rapports de force entre acteurs y sont en partie corrélés. D’un
autre côté, les projets législatifs de participation citoyenne se heurtent à un système
complexe. Alors que la loi BACHELOT de juillet 2003 crée les CLIC (comités locaux
d’information et de prévention autour des zones à risques), les responsables peinent à
entrevoir les modalités de la participation. L’organisation de la gestion des risques devrait
19 Cette analyse se base essentiellement sur le contenu des entretiens. Malgré l’axe donné aux relations élu et préfet, nous
n’avons que peu pu nous appuyer sur l’ouvrage dirigé par Claude GILBERT, ce dernier abordant surtout la répartition
des compétences pré-crises, lors de crises et post-crises. Nous n’hésitons cependant pas à en éclairer nos résultats.
20 Le premier acte législatif de grande ampleur du 22 juillet 1987 sur la sécurité civile instaure une première répartition
des rôles selon la formule : « les risques quotidiens aux maires, les risques majeurs à l’Etat ». Plus de quinze années
après, la loi sur la modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 confirme le rôle de direction des préfets dans la
préparation et la gestion des crises. Côté financement, le projet édicte de nouveau : « à risque quotidien, moyens de
secours quotidiens ; à risque exceptionnel, solidarité nationale ».
21 Par exemple, les dysfonctionnements récurrents entre cabinets d’experts/d’audit et collectivités.
8
se pencher sur une répartition des territoires, des compétences mais aussi des cultures de
travail.
2.3 Le dilemme des temporalités
L’administration publique est face au défi de l’incertain. La gestion des risques doit
être à la fois une protection d’urgence contre les dangers et un centre de prospective pour
les populations. Sa fonction s’étire entre ces temporalités : face aux catastrophes, un
principe d’action dans un temps court, que les administrés voudraient infiniment bref ; et
celui de la prévention à long terme, de l’étude, de la projection dans l’avenir.
Lors des entretiens, Georges PASINI, directeur général de la Prévention et de la
Protection pour la Ville de Lyon, nous explique que les directions « sécurité » et
« hygiène-santé » fonctionnaient ensemble auparavant. Cette fusion n’a pas duré. La
division s’est refaite entre « ce qui pouvait tuer tout de suite, c’est du risque et ça relevait
de la sécurité, et ce qui pouvait tuer un peu plus longuement, c’était de l’environnement».
Les professionnels de la sécurité et de l’hygiène-santé se sont retrouvés sur des
temporalités d’action différentes. « Bien qu’il y ait des urgentistes chez les médecins qui
peuvent agir très rapidement, nous avons une culture de l’urgence dans cette direction qui
fédère, qui est commune (…) Devant un certain nombre de problèmes, on s’est trouvé un
peu déphasé en terme de culture et de fonctionnement face à des médecins qui, sur les
problèmes de l’hygiène, avaient des perspectives beaucoup plus longues, ce qui faisait un
décalage en terme d’activités, de mode de fonctionnement. » Les temps de l’action sont
différents entre l’action et la prévision, mais aussi les réflexes, les méthodes et les logiques
d’appréhension des risques. La gestion des risques se diviserait, d’un côté, avec une culture
de l’urgence de la sécurité qui conditionnerait aux façons de faire décrites comme
« problème-solution-action », et, d’un autre côté, avec les préventeurs environnementaux
ou sanitaires qui seraient, quant à eux, dans l’analyse, la réflexion et la décision élaborée.
Ce cloisonnement tient du dilemme contemporain de l’incertitude dans le temps
face auquel est confronté le décideur. Il ne peut supposer les caractéristiques du risque
parfaitement connues. Peut-il faire de la « prévision opérationnelle » ? La gestion des
risques se heurte aux difficultés de quantifier les probabilités et pose le problème du timing
optimal de l’intervention. Faut-il attendre d’avoir la certitude de l’occurrence du risque
avant d’agir22 ? Tant que le risque ne se réalise pas, l’acteur révise à la baisse la
vraisemblance de ce risque dans sa gestion (GOLLIER, 2002). Deux séries de paramètres
individuels en théorie microéconomique expliquent cette attitude : les comportements
développent une aversion des risques et une préférence temporelle pour le présent, horizon
décisionnel privilégié.
Conclusion
Les dilemmes de durabilité et de vulnérabilité, de temporalité et de localisation de
l’action publique, de coopération partenariale et de projet dans le long terme sont posés
aux politiques publiques qui recherchent la transversalité des disciplines d’intervention, la
gouvernance multiniveau et la coopération entre les actions des acteurs. Il existe une
dynamique de recherche de transversalité dans l’action publique locale. Ces services
administratifs proposent une nouvelle typologie et définition risques urbains. L’existence
même de structures dédiées aux risques au sein des organigrammes est en la preuve. Elles
sont à la fois vitrine des formes opérationnelles possibles, des guides d’exemples possibles
et des laboratoires d’expériences. De nouveaux profils multidisciplinaires professionnels
sont recherchés, privilégiant dialogue et concertation. Une gestion supra communale qui
apporterait mutualisation des moyens, des savoirs-faire, rentabilité du matériel et autres
économies toujours en l’élaboration.
22 C’est bien la question, le débat et finalement les décisions actées par le principe de précaution.
9
III - Dans quelle mesure l’étude du développement durable peut éclairer l’analyse de
l’organisation administrative et politique de gestion du risque ?
Comprendre les liens
Que l’entrée par le développement durable soit un terrain propice pour une gestion
territoriale des risques est tout d’abord un constat de terrain. Les services de gestion des
risques sont souvent intégrés aux politiques environnementales et de développement
durable. Les collectivités positionnent la gestion des risques dans les directions
Environnement/Santé. L’autre tendance est de classer les services de gestion des risques
avec la Sécurité/Protection publique. Nous nous demandions si le développement durable
jouait ce double rôle de catalyseur de transversalité des domaines disciplinaires
d’intervention publique et d’illusion motrice permettant l’innovation des pratiques
administratives ?
Le modèle de croissance industrielle porte atteinte à l'environnement, notamment
en créant des risques graves sur le territoire. La prévention des risques est nécessaire pour
continuer à prévenir, maîtriser et remettre en état les situations de crise. Elle serait curative
là où le développement durable serait préventif. Elle travaille à l’internalisation des risques
de rupture du développement. La gestion des risques oeuvrerait à la préservation des
milieux, urbains et ruraux, et le développement durable en assurerait la pérennité. La
question qui porte débat aujourd’hui porte sur les options mélioratives et les changements
proposés. La gestion des risques comme le développement durable étant accusés par
certains économistes (LATOUCHE, 2004) de contribuer au maintien d’un modèle de
croissance fondé sur l’accumulation des richesses, destructeur de la nature et générateur
d’inégalités sociales. « Durable » ou « soutenable », le développement demeure dévoreur
du bien-être.
De nombreuses thématiques sont conjointes aux deux analyses.
- La même vision du développement et le constat commun de la polarisation inégalitaire
des risques questionne les modalités de la prise en compte des besoins des générations
futures. Comment pouvons-nous anticiper les modes de vie, de consommation, d’habitat de
demain ? Comment appréhender les risques futurs alors qu’il est déjà difficile d’anticiper
ceux d’aujourd’hui ? L’action publique de prévention et de prospective est encore mal
définie dans les collectivités locales où la logique d’intervention d’urgence prévaut. Les
réponses sont compartimentées et les conséquences peu globales. Le paradoxe commun
aux deux politiques, qui s’établit dans le traitement préventif des risques, est que le gage de
réussite d’une action de prévention se constate par le non-événement, par l’absence de
visualité des conséquences du programme engagé.
- Les nouvelles formes de l’action publique sont au coeur de ces préoccupations. Comment
créer des liens entre politiques sectorielles sans nier l'ensemble de leurs caractéristiques
professionnelles, culturelles, organisationnelles… ? Il y a un souci commun d’interroger
les marges de capacités de régulation d’une démarche processuelle de transversalité. Une
gestion transversale offrirait un espace renouvelé de redéfinition et de réflexivité,
impliquant un rapport à l’innovation et d’adaptation à une réalité globale. Dans ce cadre,
l’organisation structurelle, identitaire et interactionniste peut-elle être considérée comme
un outil permettant l’articulation entre le local (naissance identité administrative
pluridisciplinaire) et le global (gouvernance territoriale des risques). Elle ne peut pas être
une condition a priori. C’est une conséquence de l’action.
- Sans tomber dans ce qu’Alain BOURDIN appelle la « vulgate localiste »23, c'est-à-dire la
valorisation systématique des entités territorialisées dans l’action publique, il s’agit de
23 BOURDIN Alain, La question locale, PUF, Paris, 2000.
10
prendre l’occasion offerte par la dynamique des politiques intersectorielles de type
développement durable ou gestion des risques pour mener une réflexion sur le rôle du
territoire local. Les responsables administratifs plaident pour une gestion d’agglomération
réelle, qui dépasserait les limites actuelles des communautés urbaines citées. Cela
permettrait en effet de prendre en compte tout ce qui constitue l’urbanité pour faire face
aux risques. Le souhait partagé de constituer un pouvoir transcommunal coordonnant des
actions disparates des communes et imposant un projet collectif semble toutefois achopper.
Les responsables perçoivent un certain comportement casanier de la part des villes qui
défendent leur autorité et leurs frontières communales. La question se pose aussi du degré
de conscience et de responsabilisation des maires dans une structure supracommunale.
Mathilde GRALEPOIS
Références
ASCHER François, La République contre la Ville. Essai sur l’avenir de la France urbaine, La
Tour d’Aigue, Ed. l’Aube, 1998.
ASCHER François, Les Nouveaux Principes de l’Urbanisme, L’aube Intervention, Paris, 2001
BECK Ulrich, La Société du risque, sur l’autre voie de la modernité, Université de Munich,
Flammarion, Paris, 2003-
BOURDIN Alain, La Question Locale, PUF, Paris, 2000
BOURRELIER Paul-Henri, L’évolution des politiques publiques des risques naturels, la
Documentation Française, Paris, 1998
CASTEL Robert, La métamorphose de la question sociale, Fayard,
COLLIN Claude, Risques Urbains, Ed. Continent Europe, Paris, 1995
CROZIER Michel - Friedberg Erhard, L’acteur et le système, Le point, Edition du Seuil, Paris,
1977
DUBOIS-MAURY Jocelyne, CHALINE Claude, Les risque urbains, Armand Colin, Paris, 2002
GODARD O., HENRY C., LAGADEC P. et MICHEL-KERJAN E., Traité des nouveaux risques.
Précaution, crise, assurance, Gallimard, Folio Actuel, Paris, 2002.
LATOUCHE Serge, Survivre au développement. De la décolonisation de l’imaginaire économique
à la construction d’une société alternative, Editions Mille et une nuits, Paris, 2004.
GOLLIER Christian, L’interaction entre le risque et le temps, in Les perspectives de la théorie du
risque, Revue Risques n°49, mars 2002.
MULLER Pierre et SUREL Yves, L’analyse des Politiques Publiques, Montchrétien, Paris, 1998
NOIVILLE Christine, Du bon gouvernement des risques, Les voies du Droit, PUF, Paris, 2003
RIST Gilbert, Le développement : histoire et croyance occidentale, Presses de Sciences Po, Paris,
1996.
THEYS L’approche territoriale du " développement durable ", condition d’une prise en compte de
sa dimension sociale Par Jacques Theys, Publié le 23/09/2002 ; site de la revue électronique
Développement Durable et Territoires, www.revue-ddt.org/dossier001/D001_A05.htm
THEYS Jacques et FABIANI Jean-Louis (sous la direction de), La Société Vulnérable, Presse de
l’ENS, Paris, 1987.
ZACCAÏ Edwin, Le développement durable : dynamique et constitution, Peter Lang, Berne, 2002.
c'un doc pdf
1La gestion territoriale des risques urbains,
un outil de développement durable ?
Penser les risques urbains
Les cours de sociologie urbaine relatent « la ville inquiète », « la ville incertaine »,
« la ville ambivalente». Violences urbaines et pollutions environnementales semblent s’y
côtoyer, mais aussi quartiers exclus et nuisances sonores ; mesure de qualité de l’air et
saturation sociale des espaces publics ; montée du chômage, du communautarisme et
dysfonctionnements des services urbains en réseau. La liste est longue où les politiques de
la Ville et celles de développement durable rencontrent la question des risques
environnementaux, sanitaires ou industriels. Cette concentration d’inégalités et/ou de
nuisances, conséquence par accumulation historique des enjeux urbains de la ville
industrielle du 19ème siècle, est flagrante dans le cas français, et plus scandalisante encore
dans les métropoles des pays en voie de développement.
Le milieu urbain exacerbe les risques. Leur présence est inéluctable, ce qui ne
signifie pas que la ville soit « délétère »1, c'est-à-dire insalubre et nuisible. La ville induit
des risques, mais ne s’y réduit pas. Le modèle de la ville tentaculaire, globale, concentrant
activités, emplois et populations se diffuse universellement2. D’une part, la ville fait partie
intégrante d’un réseau territorial complexe, générateur inhérent de risques, et, d’autre part,
elle peut être atteinte dans son organisation sociale, économique et politique par
l’occurrence d’un danger, interne comme externe, naturel ou industriel. Le risque urbain
est défini comme l'ensemble des risques liés au territoire de la ville, c'est-à-dire à la fois les
« risques manufacturés » (BECK, 2003) et les risques pouvant survenir sur l’espace urbain.
Ceux-ci ne se limitent pas aux risques naturels et technologiques. L’espace urbain
juxtapose à la fois des risques territorialisés, inscrits dans un espace délimité (incendie,
éboulement) mais aussi des risques de réseau touchant un nombre indéfini d’acteurs (risque
aérien, ferroviaire, informatique) ; et enfin, des risques diffus, dont l’espace d’impact ne
peut être circoncit tels que la pollution de l’air ou la légionellose3.
Fabriquer la ville durable est aujourd’hui, d’une part, un enjeu d’innovation
administrative et politique et, d’autre part, un ensemble d’actions concrètes et
d’expériences menées. En tant que danger ou phénomène néfaste, plus ou moins prévisible,
ne dépendant pas exclusivement de la volonté des parties et pouvant causer dégradation,
perte ou tout autre dommage4, le risque se définit par cet aléatoire, cette probabilité de
l’accident5. L’espace d’impact, quand il peut être prévu, correspond rarement à un
périmètre administratif délimité. La gestion des risques, tout comme les politiques de
développement durable, sont un régime du contradictoire et de l’incertain. L’enjeu de
l’action publique est de s’adapter à cette contingence, à cette complexité postmoderne
(ASCHER, 2001).
L’organisation administrative locale de la gestion des risques
Notre étude porte particulièrement sur l’action publique municipale et
intercommunale : la Communauté urbaine de Nantes Métropole, « mission Risques et
Pollutions » sous la direction de M. Joël GARREAU ; la Ville de Lyon et la communauté
urbaine du Grand Lyon, respectivement « mission Sécurité et Prévention » et « mission
Risques Majeurs », sous la direction respective de MM. PASINI et DELACRETAZ.
1 Expression de Sabine BARLES dans son ouvrage La Ville délétère, Coll. Milieux, Ed. Champ Vallon, Paris, 1999.
2 Sur le cas particulier des villes européennes, lire LE GALES Patrick, Le retour des villes européennes : sociétés
urbaines, mondialisation, gouvernement et gouvernance, Presses de Sciences Po, Paris, 2003.
3 GALLAND Jean-Pierre, Calculer, gérer, réduire les risques : des actions disjointes ? Annales des Ponts et Chaussées,
n°105, janvier-mars 2003.
4 Petit Larousse 2002
5 Nous nous distancions en ce sens des définitions des géographes qui voient dans le risque une représentation sociale du
danger autour du quel un groupe social se mobilise.
2
A partir des données recueillies sur ces terrains6, nous allons :
1) présenter les enjeux communs à ces deux politiques intersectorielles :
2) voir comment les services locaux de gestion des risques y répondent
3) et d’essayer de comprendre les liens entre l’organisation publique du développement
durable et de la gestion de risque.
Nous émettons l’hypothèse que certains enjeux et certains paradoxes propres aux
politiques intersectorielles se retrouvent dans l’action publique de développement durable
et de gestion des risques. Une question focus en ressort : Comment penser la durabilité face
à l’instantanée (gestion des crises) et à l’incertain (aléa) contemporains ?
I- Des enjeux communs
Des quartiers de cumuls
La ville trop exposée aux risques n’est pas durable. Dans l’espace territorial français, des
quartiers fragiles et vulnérables existent aux abords des grandes villes. Ces espaces de
marginalisation cumulée concentrent chômage, difficulté d’intégration, déscolarisation,
échecs des politiques de prévention sanitaire et sociale... Face aux pressions financières
inflationnistes du foncier, il n’est pas rare que ces quartiers soient implantés sur des
territoires à risques :
- risques industriels liés d’une part à la localisation périphérique à proximité des
grands axes de communication (nuisances sonores, qualité de l’air, transports de
matières dangereuses, ligne à haute tension.. ; exemple :Val d’Argent,Argenteuil),
mais aussi à la proximité de zones d’activités et donc d’emploi (risques industriels
de tout genre : fuite toxique, explosion, écoulement… ; exemple : explosion de
l’usine AZF, Toulouse);
- risques naturels liés notamment à une localisation en zones inondables, sur des sols
instables, sur des cavités (exemple : Balmes lyonnaises, Lyon) ;
- dégradation des services en réseaux augmentant problème de salubrité et d’hygiène
publique, ceci allant des services d’eaux usées à réseaux électriques fournissant
lumière et chauffage.
Selon Jacques THEYS, « le cumul des risques environnementaux et industriels, mais aussi
urbains et sociaux dans des quartiers dépotoirs » doit interpeller les politiques de
développement durable afin de s’interroger sur la durabilité des situations en proie à une
vulnérabilisation sociale et urbaine grandissante7.
1-1 Définitions : proximité et limites de l’analyse comparative des politiques de
développement durable/gestion des risques en terme d’action publique locale
L’utilisation inflationniste des appellations de « développement durable » et
« gestion des risques » appellent au préalable un effort de définitions.
Le risque est un terme polysémique, fondamentalement philosophique et politique.
Communément, le risque est l’éventualité, la probabilité de l’accident en tant que situation
dangereuse susceptible d'entraîner des pertes. Une lecture étymologique montre que le mot
« risque » provient du latin resecare8, qui signifie couper le cours des choses, l’ordre
établi, le quotidien par la survenance imprévisible d’un danger ; et du grec byzantin
6 A ce stade d’avancement, je n’ai analysé que des services administratifs de gestion des risques et non des missions de
développement durable. Je me base donc, d’une part, sur les conclusions du mémoire de DEA Mutations Urbaines et
Gouvernance Territoriale « les capacités de régulation d’une gestion transversale et multipartenariale des risques dans
l’action publique locale » et, d’autre part, sur la problématique de travail de thèse engagée sur « la structuration
administrative des services intercommunaux de gestion des risques ».
7 THEYS L’approche territoriale du " développement durable ", condition d’une prise en compte de sa dimension
sociale Par Jacques Theys, Publié le 23/09/2002 ; site de la revue électronique Développement Durable et Territoires,
www.revue-ddt.org/dossier001/D001_A05.htm
8 DUBOIS Jean, MITTERAND Henri et DAUZAT Albert, Dictionnaire étymologique, Larousse, Paris, 2001.
3
rhizikon « hasard »9 ou plus précisément le solde gagné par chance par un soldat de
fortune, ce qui introduit la notion de gain potentiel. En effet, Le Larousse (1992) définit le
risque par l’attente de conditions de succès, « en assumant la responsabilité de quelque
chose, d’une entreprise » c'est-à-dire osé, licencieux. Nous nous situons tout de suite dans
le débat autour d’un risque valorisable ou non. Au coeur de cette ubiquité, le risque est ici
entendu comme un danger face auquel l’action publique se mobilise, qui l’appréhende
globalement comme une contrainte de gouvernement. Le terme de risque est mobilisé dans
des situations où se croisent un aléa, c'est-à-dire un danger, et des enjeux humains,
économiques, naturels, patrimoniaux… La gestion des risques sera l’action de prévenir les
dangers internes et externes, d’assurer la sécurité du territoire, ainsi que celle des citoyens,
afin de contrôler le fonctionnement urbain et d’en réduire les vulnérabilités.
Le développement durable serait, selon la définition du rapport BRUNTLAND
(1987), « agir de manière à satisfaire les besoins des générations présentes sans
compromettre la possibilité des générations futures de satisfaire les leurs». C’est le passage
dans les priorités d’action, publique dans notre cas, de la rentabilité économique à court
terme à une efficacité allocative à long terme ; de la recherche de l’égalité sociale à celle
d’une efficacité distributive ; et de la stricte conservation des richesses à une équité
environnementale. Le développement durable a deux histoires : la première explique
comment se réalise le prolongement logique des théories écologistes dans les réflexions sur
le développement (ZACCA, 2002) ; la seconde privilégie la notion de rupture,
d’innovation du concept et sa portée politique (RIST, 1996). Selon Jacques THEYS, la
première définition est un peu réductrice, car le rapport BRUNTLAND est une véritable
rupture historique. Le développement durable est représenté dans sa forme explicative de
stratégie des « Trois E ». Les projets doivent pouvoir prendre en compte les facteurs
environnementaux (préservation des ressources à long terme, prévention des risques), les
facteurs économiques (efficacité et maintien de la croissance) et les facteurs éthiques ou
sociaux (principe d'équité sociale, de non-ségrégation)
L’histoire du développement économique, social et politique crée des défis
communs entre politique de développement durable et gestion des risques. Comment
expliquer le rapprochement opéré par les théoriciens et les gestionnaires publics entre ces
deux définitions ?
Les conséquences de la croissance démographique et économique sur
l'environnement, l'essor productif et la diversité des besoins (agricoles, industriels,
énergétiques, hydrauliques, technologiques) pèsent de plus en plus sur l'exploitation des
ressources naturelles : elles se raréfient, ce qui vulnérabilise les territoires. L'augmentation
des demandes s'accompagne d'une exploitation accélérée de l'environnement. Les modes
de production et de consommation de la société industrielle et post-industrielle portent
atteinte aux patrimoines collectifs, aux grands équilibres de l’écosystème, génèrent des
comportements de gaspillages. Ils menacent aussi les conditions mêmes de la vie en
augmentant l’occurrence de risques. Le changement d'attitude vers une prise en compte
raisonnée de l’environnement et des données culturelles dans l’économie résulte d'une
nouvelle appréhension des "externalités". Le risque apparaît comme le mal social global
qui déstabilise l’activité économique, complique l’exercice de l’activité politique et
fragilise la confiance sociale entre citoyens et institutions10. Le paradoxe est flagrant entre,
d’une part, progression du sentiment d’insécurité et, d’autre part, amélioration de la
sécurité et de l’hygiène par les progrès des sciences et des savoir-faire. Une étude en terme
de rationalité expliquerait ce point, mais ce n’est pas notre sujet.
Le risque apparaît alors comme un système de pensée, un nouvel axe
d’appréhension des externalités des systèmes (économiques, territoriaux) de production et
9 Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, Paris, 2002.
10 NOIVILLE Christine, Du bon gouvernement des risques, Les voies du Droit, PUF, Paris, 2003.
4
d’exploitation, et aussi comme une ressource politique, une catégorie d’action publique. La
fin de la foi scientiste dans le risque zéro interroge les nouveaux modes de gouvernement.
En 1993, le Ministère de l’Equipement fait paraître les actes de son deuxième séminaire
« sécurité-risques-insécurité »11 dans l’ouvrage Les insécurités urbaines. Le discours tenu
encourage une gestion des risques transdisciplinaire et globale pour répondre à
l’omniprésence de la probabilité de dysfonctionnements. L’administration des risques12 est
un processus d’amont en aval, englobant les phases de prévision et de prévention, de
maîtrise et de gestion de crises, de retours d’expériences et d’évaluation.
L’objet d’une politique publique est la résolution de problèmes par l’élaboration
d’un système d’action concret au sein duquel des acteurs vont mobiliser des ressources
diverses au service de stratégies de pouvoir13. On ne parle donc pas aujourd'hui de
« politique publique du risque » mais les domaines d’action publique sectoriels - risques
naturels et risques technologiques principalement - sont nombreux. Si les politiques de
développement durable et de gestion des risques ont des enjeux communs à relever, reste à
se demander, à l’instar des réflexions soulevées par Jacques THEYS, si la surabondance de
politiques transversales convergentes aide à la définition d’objectifs clairs et à l’élaboration
d’actions spécifiques ?
1-2 Agir sur l’incertain
Comme nous l’avons vu, les politiques publiques de développement durable et de
gestion des risques cherchent la mise en place à solutionner les conflits d’objectifs posés à
l’action publique. Les politiques intersectorielles doivent gère l’emboîtement et la
coordination des compétences juridiques croisées des collectivités. En effet, les défis de la
gouvernance complexe peuvent être résumés :
- l’accumulation de territoires (géographique, institutionnel, vécu). Questionner les
rapports sensibles et pragmatiques portés aux territoires incite les politiques publiques à se
situer dans un espace choisi, ou du moins décidé et donc qui doit pouvoir être argumenté,
expliqué. Plutôt que de proposer des réponses, cette intervention posera des pistes de
questionnement sur le rôle que peuvent jouer les intercommunalités dans ce débat.
- la superposition des systèmes d’acteurs. Le processus de métropolisation, la
régionalisation dans le cadre de l’élargissement européen, mais aussi le redémarrage des
dynamiques de décentralisation ainsi que les revendications des collectivités locales
bouleversent les frontières traditionnelles inter et intra-étatiques. Ces mouvements de
recomposition des territoires institutionnels permettent à l’action publique locale de
repenser son organisation politique, administrative et juridique.
- l’empilement de différentes temporalités d’action : entre prévention et anticipation,
maîtrise et opérationnalité, appréhension de l’urgence et travail de mémoire, quelles
peuvent être les formes acceptables permettant de faire travailler ces domaines ensemble ?
L’organisation de nouveaux outils, voire de modèles, de gestion, de régulation et de
coordination sont au coeur de nos interrogations, mais aussi de nos observations antérieures
lors du travail de recherche en DEA. La transversalité dans la gestion locale et
multiterritoriale présente-t-elle une approche renouvelée de l’action publique ? Permet-elle
de résoudre les contradictions spatio-temporelles ? On entend par « transversalité » la prise
11 Les Insécurités Urbaines, actes du séminaire II « sécurité-risques-insécurité », Ed. STU, Paris, 1991.
12 L’administration des risques est le terme ancien de management des risques, peu utilisé en France pour ses
connotations bureaucratiques, dérives communes du terme wébérien, mais largement répandu dans le management en
Amérique du Nord. Nous l’utilisons ici en synonyme de « gestion ».
13 Selon la définition de Michel CROZIER, c’est un « espace d’échanges finalisé entre acteurs, constitutif de relations de
pouvoir en fonction de ressources mobilisées » Les politiques publiques constituent un cadre normatif d’action, un
ensemble de mesures concrètes, comme un financement, des textes de loi ou un personnel administratif et politique
Ensuite, une politique publique est l’expression de la puissance publique. Il y a toujours une notion de décision ou
d’allocation de ressources, de nature plus ou moins autoritaire, basée sur le principe de relations dissymétriques entre
l’Etat et les citoyens. Enfin, elles constituent un ordre local, instaurant une régulation des conflits entre les administrés,
image d’une construction d’un rapport au monde, d’un référentiel selon Pierre MULLER.
5
en compte de la connexité des disciplines, des territoires, des acteurs en tant que nécessité
pragmatique de gestion et exigence procédurale de réflexivité14.
Mais ne doit-on pas se ranger, avec ses détracteurs, à penser qu’une approche
transversale n’invente pas d’outils simples, synthétiques et synthétisants, mais au contraire
accroît la sectorisation en multipliant les domaines d’intervention ? Ce thème de
transversalité n’est-il qu’un outil « à la mode » tentant de résoudre en vain les complexités
inhérentes à une réalité culturelle, sociale, économique ou politique ? Ces questions ont
leur importance scientifique et théorique.
- La coopération est désormais résolument multiniveaux. Les politiques publiques sont
largement territorialisées, c’est-à-dire que les territoires sont les cadres de l’action
publique et des coopérations entre acteurs15. Les négociations sont ponctuelles,
réparties par site. Une analyse cloisonnée par territoires tend à provoquer des
dysfonctionnements en cascade.
- Les études d’acteurs sont souvent sectorisées. Les logiques territoriales, les intérêts
particuliers, les stratégies d’ensemble et les finalités d’action sont rarement interreliés.
Si l’étude paraît théorique, les conséquences sont pourtant visibles au quotidien.
- Les temporalités de la gestion des risques sont strictement séparées : un temps pour la
gestion, un temps pour la crise et un temps pour les bilans. Ce cloisonnement masque
la nécessaire prise en compte du processus général de décision. Les choix des acteurs et
leurs conséquences ne peuvent être isolés dans le temps.
Conclusion
La volonté d’une étude comparative de la genèse des structurations des services
administratifs de développement durable et de gestion des risques permettrait d’étudier les
différences de prise en compte des enjeux, les outils de solution apportés et les orientations
choisies. Le développement durable ou la gestion dans risques jouent-t-ils ce double rôle,
d’une part, de catalyseur de transversalité des domaines publics d’intervention et, d’autre
part, d’illusion motrice permettant l’innovation des pratiques administratives ?
II – L’organisation des services administratifs de gestion des risques dans les
collectivités locales
Les expérimentations de gestion transversale
La recomposition des territoires institutionnels permet d’appréhender le
développement durable dans de nouveaux espaces géographiques, politiques, administratifs
et juridiques. En France, certaines municipalités et EPCI (Etablissement Public de
Coopération Intercommunale) se réapproprient l’organisation mutualisée des services
publics administratifs. En s’intéressant à leur validité institutionnelle, notre but est de
comprendre en quoi il y a, ou non, avancée théorique sur la transversalité dans l’action
publique locale et en quoi il y a, ou non, expérimentations concrètes.
2.1 Des territoires transcalaires
Cette expression utilisée par Valérie NOVEMBER dans Les territoires du risque,
signifie, qu’en plus de croiser des territoires géographiques différents, la gestion des
risques engage des espaces politiques et vécus disparates, voire discordants.
L’auteur invite à prendre en compte la connexité entre territoire physique et risques.
En constante évolution, le territoire subit de plein fouet les dynamiques aléatoires des
14 La transversalité peut être appréhendée comme une réponse technique et scientifique de régulation à un problème
donné, une réponse de gestion face à de nouveaux objectifs propres à la gestion des risques, une réponse de flexibilité
face à un environnement instable. Elle se caractérise par ses caractères de réflexivité, d’innovation et de coopération.
15 Il serait d’ailleurs pertinent d’interroger sur la validité normative ou non des territoires comme espace a priori de
résolution, d’expérimentation, de coopération…
6
risques. Bien que certains dangers se caractérisent par une absence de limites spatiales, les
accidents surviennent néanmoins sur des espaces concrets. La gestion des risques, au delà
des connaissances techniques, statistiques, météorologiques ou géomorphologiques, exige
une sensibilité, une attention portée aux évolution territoriales. Ghislaine MAGNE,
responsable de la direction « Sécurité civile et Sécurité du public » explique d’ailleurs :
« On se doit, et ça c’est ma conviction, de connaître les entreprises, le tissu industriel de
petites et moyennes entreprises également (…) Nous sommes là aussi pour faire de
l’analyse de tissu urbain. » La gestion des risques est un exercice de réceptivité des
constantes et des fractales territoriales, un rapport renouvelé au « local ». Lieu de
réalisation du lien social, d’enracinement identitaire ou de démocratie de proximité,
l’espace local offrirait des réponses adaptées, situées, « à taille humaine », atouts
recherchés, ou du moins espérés, par les politiques et les populations.
Une interrogation demeure cependant : ces territoires géographiques et vécus du
risque peuvent-ils être rendus compatibles dans un périmètre institutionnel ? Les services
administratifs révèlent un véritable manque de ressources humaines, financières et
technique, notamment dans les moyennes et les petites communes16, tout au moins leur
éparpillement. Généralement, chaque ville gère « ses » risques territoriaux isolément des
communes, sans cohérence entre les politiques de prévention et de gestion de risque. Les
responsables administratifs souhaitent une gestion supracommunale17 qui permettrait, tout
d’abord, une mutualisation des moyens, des savoirs-faire et ensuite qui rentabiliserait le
matériel, nécessaire mais onéreux et finalement rarement utilisé. Des économies d’échelle
seraient réalisées et de nouvelles capacités d'investissements seraient offertes.
Si le consensus se fait autour des potentiels bienfaits, la forme des partenariats et
l’identité transcommunale sont variables. Selon nous, le moment de l’élaboration
d’objectifs est plus important que l’attribution a priori d’un périmètre institutionnel ou
géographique. Pourtant, le fait que l’idée de regroupement communal fasse son chemin
prouve que les attentes existent.
2.2 La recherche de coopération entre niveaux décisionnels
L’administration des risques, qu’elle soit européenne, nationale ou locale, est
aujourd’hui face à plusieurs centres de décisions administratifs et plusieurs acteurs
institutionnels. Les niveaux communaux, intercommunaux, départementaux, régionaux et
nationaux sont sollicités, parfois tous de concours18. Le manque de cohérence constaté
pose un problème d’égalité et d’équité territoriales mais aussi de risque organisationnel et
d’effet domino. Michel BARDOUILLET fait l’observation suivante : « On ne peut pas
s’en sortir, il est impossible que les villes travaillent chacune pour elle alors que le
problème peut venir de chez le voisin. A partir du moment où une rivière ou un fleuve
traverse plusieurs communes, il est évident que les désordres vont toucher plusieurs
communes. » L’intervention concomitante de pôles politiques et administratifs appelle une
clarification du jeu d’acteurs.
Le jeu d’acteurs impliqués dans la gestion des risques paraît si alambiqué qu’en
dresser un tableau est en soi un pari. Nous avons procédé à l’étude de deux systèmes
d’acteurs : celui au sein de la collectivité entre les services administratifs communaux et
intercommunaux en présence. Le second comprend une quantité difficilement dénombrable
d’acteurs, dans lesquels se retrouvent principalement l’Etat, ses services déconcentrés, la
collectivité locale et la société civile.
- Au sein des services administratifs, qu’ils soient transversaux ou sectorisés, la
gestion des risques a un rôle interservice de pilotage des dossiers, un rôle de transmission
16 Livre blanc des risques majeurs dans les collectivités territoriales, document élaboré par le CNFPT et l’ENACT, 1990.
17 Dans le sens d’un pôle de communes agglomérées, pas strictement en terme d’EPCI.
18 Nous n’avons eu à aborder les implications internationales uniquement dans le cas de la transposition de la directive
européenne SEVESO. Ce simple exemple montre que l’Union européenne est aussi source de droit en matière de gestion
de risques.
7
et de coordination entre les acteurs des services administratifs d’intervention - soit les
services techniques urbains de type voirie, assainissement, déchets ou droits des sols, soit
le développement urbain comme l’aménagement du territoire, la politique de la Ville ou les
politiques d’agglomération. A la fois techniciens et experts, il est difficile de savoir si ce
rôle entre-deux est vécu comme valorisant ou non. En effet, le constat du manque de
moyens démontre le manque de reconnaissance véritable dans les organigrammes des
collectivités. Cette carence concerne non seulement les ressources humaines et techniques
mais aussi politiques et juridiques. Au-delà des revendications budgétaires, un portage
politique et une base de compétences légales sont nécessaires pour assurer le respect de la
réglementation et pour assumer les responsabilités des élus. Les responsables de services
pointent l’absence « d'élu synthèse », c'est-à-dire d’élu référent, de porte-parole, de
représentation politique. Dès lors, le maire apparaît comme le recours naturel face aux
situations de crise. Il est considéré comme l’acteur principal de la vie municipale, identifié
et repéré de tous. La préoccupation de sécurité des citoyens nécessite une présence
quotidienne, une véritable culture de la disponibilité au public. Le maire est face à un
nombre croissant de demandes, d’attentes et d’objectifs contradictoires sur le territoire de
sa commune, comme l’implantation d’entreprise ou la préservation de zones dites à risque.
Or, le manque de moyens mis à la disposition de l’aide à la décision en gestion de risques
renvoie le maire à une kyrielle de responsabilités juridiques qu’il ne semble plus pouvoir
différencier.
- Les cellules locales de gestion des risques s’inscrivent aussi dans un système
d’acteurs externe à leur collectivité. Ce système est diffus et marqué par les relations entre
le préfet et le maire. Les pénuries de moyens, de légitimité politique ou les superpositions
de compétences juridiques vont cristalliser les revendications de chacun autour d’un même
objectif : obtenir une répartition stricte des responsabilités pour garantir une unité de
commandement19. Le maire exerce son pouvoir sous le double contrôle politique, d’une
part, du conseil municipal et administratif, d’autre part, du représentant de l’Etat dans le
département. Le préfet dispose d’un pouvoir de police générale qu’il exerce ainsi dans les
mêmes domaines en cas de carence, de silence, de défaillance des maires et lorsque
l’espace menacé excède la superficie de la commune. Inscrit dans le jeu global des acteurs
nationaux et locaux, les services de gestion des risques peinent à assurer au maire une
position stable et clairement définie dans un système aux compétences juridiques et aux
responsabilités administratives et pénales désunies20. Leurs ressources apparaissent
dérisoires pour recouvrir la prévention des risques et la protection des populations au
quotidien. L’Etat, par la présence du préfet et des services déconcentrés (en grande partie :
DDE, DRIRE, DDAF et DIREN), reste garant de la sécurité des citoyens sur le territoire.
Autour de ce binôme gravite un nombre instable d’acteurs externes, publics et privés.
Or, certains mécanismes de coordination sont en crise21 et s’inscrivent dans un système
assez étanche. La force des messages médiatiques influence l’ordre d’importance, publique
et politique, des risques. Les rapports de force entre acteurs y sont en partie corrélés. D’un
autre côté, les projets législatifs de participation citoyenne se heurtent à un système
complexe. Alors que la loi BACHELOT de juillet 2003 crée les CLIC (comités locaux
d’information et de prévention autour des zones à risques), les responsables peinent à
entrevoir les modalités de la participation. L’organisation de la gestion des risques devrait
19 Cette analyse se base essentiellement sur le contenu des entretiens. Malgré l’axe donné aux relations élu et préfet, nous
n’avons que peu pu nous appuyer sur l’ouvrage dirigé par Claude GILBERT, ce dernier abordant surtout la répartition
des compétences pré-crises, lors de crises et post-crises. Nous n’hésitons cependant pas à en éclairer nos résultats.
20 Le premier acte législatif de grande ampleur du 22 juillet 1987 sur la sécurité civile instaure une première répartition
des rôles selon la formule : « les risques quotidiens aux maires, les risques majeurs à l’Etat ». Plus de quinze années
après, la loi sur la modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 confirme le rôle de direction des préfets dans la
préparation et la gestion des crises. Côté financement, le projet édicte de nouveau : « à risque quotidien, moyens de
secours quotidiens ; à risque exceptionnel, solidarité nationale ».
21 Par exemple, les dysfonctionnements récurrents entre cabinets d’experts/d’audit et collectivités.
8
se pencher sur une répartition des territoires, des compétences mais aussi des cultures de
travail.
2.3 Le dilemme des temporalités
L’administration publique est face au défi de l’incertain. La gestion des risques doit
être à la fois une protection d’urgence contre les dangers et un centre de prospective pour
les populations. Sa fonction s’étire entre ces temporalités : face aux catastrophes, un
principe d’action dans un temps court, que les administrés voudraient infiniment bref ; et
celui de la prévention à long terme, de l’étude, de la projection dans l’avenir.
Lors des entretiens, Georges PASINI, directeur général de la Prévention et de la
Protection pour la Ville de Lyon, nous explique que les directions « sécurité » et
« hygiène-santé » fonctionnaient ensemble auparavant. Cette fusion n’a pas duré. La
division s’est refaite entre « ce qui pouvait tuer tout de suite, c’est du risque et ça relevait
de la sécurité, et ce qui pouvait tuer un peu plus longuement, c’était de l’environnement».
Les professionnels de la sécurité et de l’hygiène-santé se sont retrouvés sur des
temporalités d’action différentes. « Bien qu’il y ait des urgentistes chez les médecins qui
peuvent agir très rapidement, nous avons une culture de l’urgence dans cette direction qui
fédère, qui est commune (…) Devant un certain nombre de problèmes, on s’est trouvé un
peu déphasé en terme de culture et de fonctionnement face à des médecins qui, sur les
problèmes de l’hygiène, avaient des perspectives beaucoup plus longues, ce qui faisait un
décalage en terme d’activités, de mode de fonctionnement. » Les temps de l’action sont
différents entre l’action et la prévision, mais aussi les réflexes, les méthodes et les logiques
d’appréhension des risques. La gestion des risques se diviserait, d’un côté, avec une culture
de l’urgence de la sécurité qui conditionnerait aux façons de faire décrites comme
« problème-solution-action », et, d’un autre côté, avec les préventeurs environnementaux
ou sanitaires qui seraient, quant à eux, dans l’analyse, la réflexion et la décision élaborée.
Ce cloisonnement tient du dilemme contemporain de l’incertitude dans le temps
face auquel est confronté le décideur. Il ne peut supposer les caractéristiques du risque
parfaitement connues. Peut-il faire de la « prévision opérationnelle » ? La gestion des
risques se heurte aux difficultés de quantifier les probabilités et pose le problème du timing
optimal de l’intervention. Faut-il attendre d’avoir la certitude de l’occurrence du risque
avant d’agir22 ? Tant que le risque ne se réalise pas, l’acteur révise à la baisse la
vraisemblance de ce risque dans sa gestion (GOLLIER, 2002). Deux séries de paramètres
individuels en théorie microéconomique expliquent cette attitude : les comportements
développent une aversion des risques et une préférence temporelle pour le présent, horizon
décisionnel privilégié.
Conclusion
Les dilemmes de durabilité et de vulnérabilité, de temporalité et de localisation de
l’action publique, de coopération partenariale et de projet dans le long terme sont posés
aux politiques publiques qui recherchent la transversalité des disciplines d’intervention, la
gouvernance multiniveau et la coopération entre les actions des acteurs. Il existe une
dynamique de recherche de transversalité dans l’action publique locale. Ces services
administratifs proposent une nouvelle typologie et définition risques urbains. L’existence
même de structures dédiées aux risques au sein des organigrammes est en la preuve. Elles
sont à la fois vitrine des formes opérationnelles possibles, des guides d’exemples possibles
et des laboratoires d’expériences. De nouveaux profils multidisciplinaires professionnels
sont recherchés, privilégiant dialogue et concertation. Une gestion supra communale qui
apporterait mutualisation des moyens, des savoirs-faire, rentabilité du matériel et autres
économies toujours en l’élaboration.
22 C’est bien la question, le débat et finalement les décisions actées par le principe de précaution.
9
III - Dans quelle mesure l’étude du développement durable peut éclairer l’analyse de
l’organisation administrative et politique de gestion du risque ?
Comprendre les liens
Que l’entrée par le développement durable soit un terrain propice pour une gestion
territoriale des risques est tout d’abord un constat de terrain. Les services de gestion des
risques sont souvent intégrés aux politiques environnementales et de développement
durable. Les collectivités positionnent la gestion des risques dans les directions
Environnement/Santé. L’autre tendance est de classer les services de gestion des risques
avec la Sécurité/Protection publique. Nous nous demandions si le développement durable
jouait ce double rôle de catalyseur de transversalité des domaines disciplinaires
d’intervention publique et d’illusion motrice permettant l’innovation des pratiques
administratives ?
Le modèle de croissance industrielle porte atteinte à l'environnement, notamment
en créant des risques graves sur le territoire. La prévention des risques est nécessaire pour
continuer à prévenir, maîtriser et remettre en état les situations de crise. Elle serait curative
là où le développement durable serait préventif. Elle travaille à l’internalisation des risques
de rupture du développement. La gestion des risques oeuvrerait à la préservation des
milieux, urbains et ruraux, et le développement durable en assurerait la pérennité. La
question qui porte débat aujourd’hui porte sur les options mélioratives et les changements
proposés. La gestion des risques comme le développement durable étant accusés par
certains économistes (LATOUCHE, 2004) de contribuer au maintien d’un modèle de
croissance fondé sur l’accumulation des richesses, destructeur de la nature et générateur
d’inégalités sociales. « Durable » ou « soutenable », le développement demeure dévoreur
du bien-être.
De nombreuses thématiques sont conjointes aux deux analyses.
- La même vision du développement et le constat commun de la polarisation inégalitaire
des risques questionne les modalités de la prise en compte des besoins des générations
futures. Comment pouvons-nous anticiper les modes de vie, de consommation, d’habitat de
demain ? Comment appréhender les risques futurs alors qu’il est déjà difficile d’anticiper
ceux d’aujourd’hui ? L’action publique de prévention et de prospective est encore mal
définie dans les collectivités locales où la logique d’intervention d’urgence prévaut. Les
réponses sont compartimentées et les conséquences peu globales. Le paradoxe commun
aux deux politiques, qui s’établit dans le traitement préventif des risques, est que le gage de
réussite d’une action de prévention se constate par le non-événement, par l’absence de
visualité des conséquences du programme engagé.
- Les nouvelles formes de l’action publique sont au coeur de ces préoccupations. Comment
créer des liens entre politiques sectorielles sans nier l'ensemble de leurs caractéristiques
professionnelles, culturelles, organisationnelles… ? Il y a un souci commun d’interroger
les marges de capacités de régulation d’une démarche processuelle de transversalité. Une
gestion transversale offrirait un espace renouvelé de redéfinition et de réflexivité,
impliquant un rapport à l’innovation et d’adaptation à une réalité globale. Dans ce cadre,
l’organisation structurelle, identitaire et interactionniste peut-elle être considérée comme
un outil permettant l’articulation entre le local (naissance identité administrative
pluridisciplinaire) et le global (gouvernance territoriale des risques). Elle ne peut pas être
une condition a priori. C’est une conséquence de l’action.
- Sans tomber dans ce qu’Alain BOURDIN appelle la « vulgate localiste »23, c'est-à-dire la
valorisation systématique des entités territorialisées dans l’action publique, il s’agit de
23 BOURDIN Alain, La question locale, PUF, Paris, 2000.
10
prendre l’occasion offerte par la dynamique des politiques intersectorielles de type
développement durable ou gestion des risques pour mener une réflexion sur le rôle du
territoire local. Les responsables administratifs plaident pour une gestion d’agglomération
réelle, qui dépasserait les limites actuelles des communautés urbaines citées. Cela
permettrait en effet de prendre en compte tout ce qui constitue l’urbanité pour faire face
aux risques. Le souhait partagé de constituer un pouvoir transcommunal coordonnant des
actions disparates des communes et imposant un projet collectif semble toutefois achopper.
Les responsables perçoivent un certain comportement casanier de la part des villes qui
défendent leur autorité et leurs frontières communales. La question se pose aussi du degré
de conscience et de responsabilisation des maires dans une structure supracommunale.
Mathilde GRALEPOIS
Références
ASCHER François, La République contre la Ville. Essai sur l’avenir de la France urbaine, La
Tour d’Aigue, Ed. l’Aube, 1998.
ASCHER François, Les Nouveaux Principes de l’Urbanisme, L’aube Intervention, Paris, 2001
BECK Ulrich, La Société du risque, sur l’autre voie de la modernité, Université de Munich,
Flammarion, Paris, 2003-
BOURDIN Alain, La Question Locale, PUF, Paris, 2000
BOURRELIER Paul-Henri, L’évolution des politiques publiques des risques naturels, la
Documentation Française, Paris, 1998
CASTEL Robert, La métamorphose de la question sociale, Fayard,
COLLIN Claude, Risques Urbains, Ed. Continent Europe, Paris, 1995
CROZIER Michel - Friedberg Erhard, L’acteur et le système, Le point, Edition du Seuil, Paris,
1977
DUBOIS-MAURY Jocelyne, CHALINE Claude, Les risque urbains, Armand Colin, Paris, 2002
GODARD O., HENRY C., LAGADEC P. et MICHEL-KERJAN E., Traité des nouveaux risques.
Précaution, crise, assurance, Gallimard, Folio Actuel, Paris, 2002.
LATOUCHE Serge, Survivre au développement. De la décolonisation de l’imaginaire économique
à la construction d’une société alternative, Editions Mille et une nuits, Paris, 2004.
GOLLIER Christian, L’interaction entre le risque et le temps, in Les perspectives de la théorie du
risque, Revue Risques n°49, mars 2002.
MULLER Pierre et SUREL Yves, L’analyse des Politiques Publiques, Montchrétien, Paris, 1998
NOIVILLE Christine, Du bon gouvernement des risques, Les voies du Droit, PUF, Paris, 2003
RIST Gilbert, Le développement : histoire et croyance occidentale, Presses de Sciences Po, Paris,
1996.
THEYS L’approche territoriale du " développement durable ", condition d’une prise en compte de
sa dimension sociale Par Jacques Theys, Publié le 23/09/2002 ; site de la revue électronique
Développement Durable et Territoires, www.revue-ddt.org/dossier001/D001_A05.htm
THEYS Jacques et FABIANI Jean-Louis (sous la direction de), La Société Vulnérable, Presse de
l’ENS, Paris, 1987.
ZACCAÏ Edwin, Le développement durable : dynamique et constitution, Peter Lang, Berne, 2002.
c'un doc pdf

saider- Je Suis Un Membre Actif
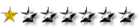
-
 Messages : 69
Messages : 69
Points : 156
Réputation : 5
Age : 59
Localisation : arch
Emploi/loisirs : architecte
 Re: villes et risques urbains
Re: villes et risques urbains
vous pouver le partage le pdf si vous voulais est sa nous rendra utile merçi
archimed-
 Messages : 3
Messages : 3
Points : 3
Réputation : 0
Age : 37
Localisation : alkhiria
 La construction du risque urbain
La construction du risque urbain
je sais pas comment poster des doc pdf alors j'essaye dde les collés j'espere que nous nous aidons a préparer ce concour; bonne chance pour tous
La construction du risque urbain en
périphérie nord-est de Cuzco (Pérou)
Nicolas Rey*
Résumé
Dans l’ancienne capitale inca, Cuzco, les pentes abruptes ont été colonisées par les habitants pauvres
n’ayant pas trouvé à se loger dans le centre-ville. Située dans une zone de forte activité sismique, Cusco
a ainsi vu ces dernières décennies deux types de catastrophes se succéder : le tremblement de terre,
comme celui de 1950, a déplacé la population vers les périphéries, qui se sont ensuite étendues sans
planification ; et depuis les années 1980, les glissements de terrain emportent les maisons en adobe
occupées en majorité par des populations indiennes et métis vulnérables. Face à l’urbanisation des
hommes, la Terre Mère, la Pacha Mama, ne serait-elle pas de retour, pour se venger ? Cet article montre
dans un premier temps comment une expansion urbaine non maîtrisée par les autorités a conduit
à la construction du risque en périphérie de Cuzco. On rentre ensuite dans le détail des stratégies
développées par les habitants quechuas et métis pour lesquels la recherche du moindre coût en se
logeant le long des pentes abruptes se fait au prix d’un risque plus grand en partie assumé. Enfin,
entre positions contradictoires des autorités selon les niveaux décisionnels (Defensa civil, mairie…), et
représentation du risque par les habitants renvoyant aux schèmes de la culture quechua, il s’agit alors de
confronter les différentes stratégies des acteurs face au risque pour espérer en améliorer sa gestion.
Mots clés : risques, quartiers périphériques, gouvernance, anthropologie, Cuzco
La construcción del riesgo urbano en la periferia noreste de
Cuzco (Perú)
Resumen
En la antigua capital Inca, Cuzco, las laderas fueron colonizadas por los habitantes pobres que no
encontraron donde vivir en el centro de la ciudad. Situada en una zona de fuerte actividad sísmica,
Cusco ha conocido dos peligros en las ultimas décadas: el terremoto de 1950 que provocó el traslado
* Docteur en sociologie du développement (La Sorbonne & IEDES) : 18, rue de la Tour, 77410 Villevaudé. E-mail:
nicolartiste@yahoo.com
260
Nicolas Rey
de la población hacia las periferias que se han desarrollado sin planificación y los derrumbes que desde
los años 1980 han destruido muchas casas de adobe ocupadas por indígenas o mestizos vulnerables.
Uno se pregunta si frente al proceso de urbanización que llevan a cabo los hombres, la Madre Tierra,
la Pacha Macha, no ha vuelto para vengarse. Este artículo demuestra cómo la expansión urbana no
planificada por las autoridades ha desembocado en la construcción en condiciones de riesgo en las
periferias de Cuzco. Luego se trata de entender en detalle las estrategias económicas desarrolladas por
los habitantes quechuas y mestizos que buscan alquileres más accesibles, pero que aceptan instalarse
en zonas altamente peligrosas como son las laderas, por falta de recursos. En fin, se trata de confrontar
las estrategias de los diferentes actores para mejorar la gestión del riesgo, frente a las contradicciones
de las diversas autoridades (Defensa civil, municipalidad...) y la representación del riesgo que tienen
los habitantes quechuas.
Palabras clave: riesgos, suburbios, gobernabilidad, antropología, Cuzco
The construction of urban risk in the north-east perifery of
Cuzco (Peru)
Abstract
In the ancient capital of the Inca Empire, Cuzco, the steep slopes have been occupied by poor
inhabitants who didn’t find anywhere to live in the city center. Localized in a zone of great seismic
activity, Cuzco has known two types of disasters in the last decades: earthquakes, like the one of
1950, that deplaced the population to the peripheries without planning; and landslides, which since
the 1980’s, destroyed the adobe houses occupied by a majority of indian and mestizo population.
Wouldn’t the Earth Mother, The Pacha Mama, come back, to exact revenge, after seeing the results of
men’s urbanisation? In the first part, this article explains how the uncontrolled urban expansion has led
to the construction of risk in the peripheries of Cuzco ; then, in the second part, we detail strategies
developed by the quechua-speaking inhabitants and mestizos who are looking for cheaper housing
prices on the high risk slopes ; finally, we examine examine contradictory positions of the authorities
at diferent levels ( civil defense, municipality...), and the representation of risk made by the inhabitants
within the context the quechua culture. We conclude by considering the strategies of the actors to
mitigate the risk and improve its management.
Keywords: risks, suburbs, governance, anthropology, Cuzco
Dans les villes de montagne latino-américaines, et en particulier andines, les glissements de
terrain se succèdent depuis plusieurs décennies dans les quartiers périphériques en pente.
Ces catastrophes surviennent dans le contexte socio-historique et politique suivant : crise du
monde rural et explosion urbaine après 1950, absence d’une planification capable d’organiser
l’expansion de la ville, classes populaires organisées en associations pour se loger, dans les
espaces restés libres, en général les plus ingrats, et régularisation après-coup par les autorités de
ces zones à risque, une fois que le « mal » a été fait.
La ville de Cuzco, située dans les Andes péruviennes, à 3 500 mètres d’altitude, n’échappe pas
à ces constantes.
261
La construction du risque urbain en périphérie nord-est de Cuzco (Pérou)
Jusque dans les années 1950, Cuzco, ancienne « capitale » inca, était principalement délimitée
par son tracé colonial. Cuzco était la ville la plus dense du Pérou : le phénomène dit de
tugurizacion dominait (surconcentration et dégradation des quartiers ainsi occupés). Il n’existait
alors pas de continuité urbaine entre le centre historique proprement dit, et les autres districts
plus éloignés1. Suite au tremblement de terre de 1950, qui ravagea plus de 3 000 maisons,
laissant sans toit de 30 000 à 40 000 personnes, Cuzco va s’étendre vers l’est. Mais ce début
de continuité urbaine se fera au prix d’une installation le long des laderas (pentes abruptes)
dominant la ville, sans planification urbaine. La municipalité de Cuzco va régulariser après coup
ces nombreux quartiers construits sur des terrains rachetés par les habitants aux ordres religieux
et aux grands propriétaires (hacendados).
Ainsi, en plus du centre historique, toujours menacé par l’activité sismique intense dans la région,
sont apparues le long des pentes de nouvelles zones à risque, nées de l’installation non contrôlée
d’habitants qui ont élaboré leur système de drainage et une trame urbaine sans cohérence avec la
ville plus formelle. Résultat : de nombreux glissements de terrains affectent régulièrement depuis
vingt ans la périphérie nord-est de Cuzco, emportant maisons et ruelles, dans la chute. Deux
glissements de terrain survenus respectivement en avril 2001 et janvier 2002 dans le secteur dit
« comité 6 » du quartier Asociacion Pro-Vivienda Los Incas2, provoquèrent la destruction de cinq
maisons, et endommagèrent deux autres constructions limitrophes. La rue centrale du comité
6, constituée d’un escalier, a également été emportée, pour moitié. En réponse, les autorités
s’accordèrent pour déclarer qu’il fallait évacuer la zone, mais leur absence de cohérence quant
aux actions à mener après la catastrophe ne firent que plonger un peu plus les habitants dans
une vulnérabilité déjà élevée avant même l’événement3.
L’exemple du quartier Los Incas, en périphérie nord-est de Cuzco, nous intéresse tout
particulièrement pour appréhender dans le détail ce qui, depuis maintenant plusieurs décennies,
a façonné cette construction du risque dans la ville andine. Plusieurs questions se posent alors :
• Comment historiquement, socialement, « urbanistiquement », les conditions amenant à des
glissements de terrain successifs dans la zone nord-est depuis les années 1980, ont-elles
été réunies, et quelles sont les parts de responsabilité des uns et des autres — habitants,
représentants de quartier, municipalité, État et services décentralisés ?
• Après la catastrophe, quelles réponses en matière de mitigation ont été apportées par ces
différents acteurs, et en fonction de quelles représentations du risque souvent opposées —
institutionnelle, « culturelle » — se positionnent-ils ?
Une double approche, à la fois anthropologique et urbanistique, permet d’apporter des éléments
de réponse.
Tout d’abord, on s’attachera à montrer comment à un type de catastrophe qui frappa le centre
urbain de Cuzco (tremblement de terre de 1950), est venue se greffer une autre menace :
le glissement de terrain, cette fois le long des pentes abruptes colonisées en périphérie. La
responsabilité des pouvoirs publics dans la construction historique du risque est ainsi retracée
dans le détail durant cette deuxième moitié du 20e siècle, à travers une présentation des choix
politiques faits en matière de gestion urbaine, face à la ville en expansion.
Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons aux parcours résidentiels des classes pauvres,
venues des campagnes environnantes ou plus lointaines (autres provinces), pour rejoindre la ville
1 Comme San Sebastián ou San Jerónimo, situés à l’est.
2 Le quartier Los Incas, apparu en 1963 en périphérie nord-est de Cuzco, est divisé en neuf comités.
3 Ces questions de gouvernance et de gestion du risque traitées dans le cas d’étude du quartier Los Incas, s’inscrivent
dans le vaste champ de recherche développé par l’Institut Universitaire d’Études en Développement et l’IP8
(Individual Project à Genève. L’IUED/IP 8 sont inscrits dans le cadre du programme de coopération de la
à Genève. L’IUED/IP 8 sont inscrits dans le cadre du programme de coopération de la
recherche suisse NCCR North-South. Le Pérou, la Bolivie et l’Argentine sont les trois pays latino-américains
d’intervention de cette équipe pluridisciplinaire, dont les responsables Isabelle Milbert et Marc Hufty méritent ici
d’être chaleureusement remerciés. Cet article, résultat de deux mois d’enquête dans le quartier Los Incas au début
2004, fait suite à l’étude Gobernancia y riesgos ambientales urbanos en Cusco réalisée par le Centro Bartolomé de
Las Casas (2003), situé à Cuzco et coopérant avec l’IUED/IP8.
262
Nicolas Rey
de Cuzco, du centre aux périphéries. Nous pourrons constater alors que la recherche de plus
d’espace habitable et d’une réduction des coûts du logement en se regroupant dans la famille
étendue, l’emporte sur le « choix » d’une exposition plus faible au risque. Dans un contexte
de crise interne après la catastrophe, quand les relais au sein du voisinage entre habitants et
leurs représentants de quartier ne fonctionnent plus, l’action collective peut être abandonnée au
profit d’un repli sur la parcelle familiale.
Enfin, nous étudierons la représentation du risque spécifique que se font les habitants indiens
(quechua) et métis des périphéries urbaines, en fonction de leur rapport notamment à la
terre considérée comme divinité agissante. Dans cette optique, nous préférerons le terme
représentation à celui de perception. Comme le soulignent très justement Pirotte et al. (2000), la
notion de perception implique qu’il y ait un risque concret, seul capable d’être pris en compte,
opposé à un autre type de risque, plus imaginaire… Or, peut-on parler d’objectivité du risque ?
Le terme de représentation permet d’assumer la complexité de l’objet, en s’appuyant sur les
systèmes cognitifs spécifiques à chaque groupe étudié, en fonction notamment de leurs cultures
et croyances propres.
Pour espérer améliorer leur sort face aux glissements de terrain à répétition, les habitants des
périphéries en pente de Cuzco ont ainsi élaboré une « culture » du risque, particulière au contexte
socio-politique de cette région péruvienne. À partir de cette étude de la construction du risque
à Los Incas, dans la périphérie nord-est de Cuzco, au-delà d’une approche fonctionnaliste et
culturaliste du risque, il s’agit donc bien de montrer comment les habitants se sont organisés
face à une absence de volontarisme politique ou à des choix contradictoires chez les autorités
débouchant sur l’immobilisme. L’approche anthropologique et urbanistique est dès lors mise au
service d’une compréhension plus large des enjeux politiques entourant la gestion du risque,
dans la ville andine.
Figure 1 – Le Pérou et Cuzco,
capitale de l’empire inca
(élaboration : Rey según www.
americas-fr.com/geographie/
cartes/carte_perou.html - 24k)
263
La construction du risque urbain en périphérie nord-est de Cuzco (Pérou)
Figure 2 – Les quartiers « à risque » en périphérie nord-est de Cuzco (élaboration : Rey, según Salas del Pino et al., 1998)
264
Nicolas Rey
Figure 3 – L’expansion longitudinale de la ville selon le phénomène de « conurbation »
(d’après : Carreño, 1994)
265
La construction du risque urbain en périphérie nord-est de Cuzco (Pérou)
1. La construction du risque par une expa nsion urbaine
non maîtrisée
Avant le tremblement de terre de 1950, on comptait 216 hab./ha à Cuzco, ce qui représentait le
taux de densité le plus élevé au niveau national (Marco Cortez, 1989). Les demandes adressées
par les autorités locales à l’État afin de répondre à la surconcentration en ville par une politique
volontariste de construction sociale (viviendas sociales), restaient lettre morte.
Il fallut attendre le tremblement de terre de 1950 pour voir finalement la ville s’étendre au-delà
de son tracé colonial. Le bilan fut très lourd, transformant Cuzco en ville de barracas :
• sur un peu plus de 4 000 maisons, seul un quart ne fut pas détruit ;
• environ 35 000 personnes se retrouvèrent sans domicile. Vingt mille décidèrent de quitter
Cuzco, tandis que le reste des sinistrés s’installa à différents points de la ville avec leurs tentes
ou leurs maisons de fortune (barracas), sur les places, les avenues, les rues… (Marco Cortes,
1989).
La catastrophe eut au moins l’effet de pousser l’État à répondre enfin à la demande en
logement à Cuzco. Une loi d’imposition sur le tabac va financer la reconstruction de la ville,
et la participation internationale sera également conséquente. Le centre sera rénové, et la ville
plus moderne va prendre vraiment forme, avec une expansion urbaine orientée délibérément
vers l’est. La ville sera divisée en districts4, selon le Projet Pilote de 1952. La Réforme Agraire
favorisa involontairement la vente de nombreux terrains, tant et si bien que l’offre devint même
supérieure à la demande, certains propriétaires préférant se débarrasser de leurs vastes superficies
à bon prix pour échapper à cette orientation politique étatique les défavorisant :
« En 1962/1963, la Réforme Agraire a favorisé la vente de terrains dans la vallée, près
du Cuzco. Les propriétaires préféraient vendre leurs terres un bon prix à une compagnie
immobilière ou le lotir eux-mêmes plutôt que de risquer de se le voir enlever par
l’administration de la Réforme Agraire contre une indemnité qui serait moins importante »
(Durand, 1970 : 17).
Les classes moyennes furent d’abord intéressées par l’expropriation, menée sous l’égide de
l’État ; puis les classes plus pauvres purent se reloger de façon moins planifiée, principalement
à l’initiative privée des ordres religieux, de l’Assistance Publique5 et des grands propriétaires
terriens (hacendados), le long des pentes abruptes (laderas) :
« Après le tremblement de 1950, les problèmes urbains structurels s’amplifièrent. Près
de 90 % des logements en ville furent affectés par le séisme, ce qui provoqua le départ
d’un grand nombre d’habitants vers d’autres aires, aujourd’hui périphériques. La plus
grande déstructuration des espaces régionaux et la relation conflictuelle ville-campagne
toujours non résolue, qui voit Cuzco ne pas être articulée de façon indépendante à son
espace régional, surtout avec une absence de développement de l’industrie, furent une
des causes qui motivèrent et accélérèrent la crise urbaine.
La prolongation de l’avenida de la Cultura dans les années 1950 sera un premier pas
important dans l’implantation de quartiers vers le sud-est, qui s’accompagne d’un
phénomène connu sous le nom de conurbation de l’espace urbain (…), sur les aires
planes qui entourent la localité de San Sebastián. La majorité de ces terrains furent
expropriés par l’État, qui devint le promoteur en logement pour les classes moyennes
de la ville. La seconde pointe d’accroissement, dans les années 60, est caractérisée par
l’apparition de nouveaux acteurs sociaux non officiels, ceux-là même qui donnèrent
4 Les districts sont aujourd’hui au nombre de cinq : San Sebastián, Huanchac, Cuzco, Santiago, et San Jerónimo.
5 La Beneficiencia Pública fut fondée en 1790, et rétablie après les indépendances, en 1833. Elle hérita des biens
donnés aux hôpitaux de Cuzco à l’époque coloniale (Brisseau, 1981).
266
Nicolas Rey
lieu à l’extension de la ville clandestine, illégale et non planifiée (…) » (Quedena et al.,
1994 : 83-84).
L’obligation de trouver un terrain où se loger va amener la création de nombreuses associations
pour le logement (Asociacion Pro-Vivienda). La direction de chaque APV acheta de vastes
superficies, cette fois de façon collective, les terrains à lotir étant redistribués ensuite entre les
différents membres de l’association. De telles associations furent d’abord créées avec le souci
d’obtenir les services comme l’eau ou l’électricité dans un second temps en faisant pression
sur les pouvoirs publics. On va donc passer d’une occupation de terrains spontanée, à un type
d’organisation plus structurée, mais en générant toujours les mêmes problèmes, les services et
l’urbanisation échappant encore à toute planification :
« Les Associations sont régies par le Décret de Loi 13 500 promulgué en 1961. Elles sont
caractérisées par le fait que les associés acquièrent des terrains rustiques de la part de
l’État, des Églises ou des propriétaires particuliers. Mais comme les coopératives, elles ne
reçoivent pas l’appui de l’État, et le processus d’urbanisation est de leur responsabilité
directe (…) » (UNSAAC, 1986 : 28).
Malgré une plus grande coopération entre propriétaires (État, Églises, particuliers) et habitants
de ces zones qui achètent les terrains à travers la Asociacion Pro-Vivienda6, c’est donc toujours la
politique de l’« après-coup » de la part des autorités qui prévaut, avec son lot de dysfonctionnements
— discontinuité de la trame foncière, incohérence dans le système d’alimentation/évacuation des
eaux, etc. — affectant à terme l’ensemble de la ville :
« L’occupation précède l’assainissement, aux normes, des terrains. Ce sera la nécessité
de se doter des services de base et communaux qui, dans un second temps, amènera les
occupants de lots à se regrouper en Associations ou Unions de Propriétaires ou lotisseurs.
(…) Il apparaîtra également des problèmes liés à l’approbation de projets d’urbanisation :
alignement des voies, faute de superficies de réserve pour les voies publiques, absence
des 10 % pour les espaces verts, des 2 % pour l’État, etc. Les projets seront finalement
approuvés après la régularisation ou la restructuration » (Marco Cortez, 1989 : 9).
Après le tremblement de terre de 1950 et la colonisation des laderas, les glissements de terrain
vont affecter régulièrement la zone nord-est à partir des années 1980. Un type de risque en
amène t-il un autre ? Certes, mais les grands responsables restent les pouvoirs publics qui, par
faute de planification en direction des classes populaires, ont laissé les lotisseurs s’emparer des
pentes, construisant ainsi des zones à haut risque en dehors de tout contrôle. Dans le quartier
Los Incas, situé en périphérie nord-est de Cuzco, le long de pentes inclinées à plus de 30 %7, les
explications techniques le plus systématiquement avancées pour évoquer le risque urbain qui le
menace, sont les suivantes :
• les maisons à majorité en adobe offrent peu de résistance aux secousses sismiques toujours
systématiques dans la région (même si elles sont généralement de faible amplitude) ;
• la nature géologique des sols le long de ces pentes amplifie les ondes sismiques ;
• le système de drainage, tant en sous-sol qu’en surface, a été conçu en dehors de tout respect
des normes de construction établies par les pouvoirs publics.
Mais c’est plus l’expansion de la ville sans contrôle, que le seul caractère « dangereux » en soi du
site initial, qui a construit le risque à Cuzco :
« (…) ce n’est pas tant le site initial qui pose problème, mais l’expansion et la segmentation
du périmètre urbanisé qui s’accompagne des modifications des sites dangereux dans
l’espace et dans le temps au fur et à mesure du développement spatial de la ville, comme
6 D’autres dénominations vont s’imposer dans les années 1970 et 1980 pour qualifier ces quartiers dominant la ville :
les quartiers apparus sous la présidence de Velasco seront dénommés pueblos jovenes. Ils seront désignés ensuite
sous le terme de asentamientos humanos (établissements humains) dans les années 1980.
7 Le quartier est d’ailleurs traversé par une rue appelée à juste titre en quechua Anden Kawarina (« mirador des
Andes »).
267
La construction du risque urbain en périphérie nord-est de Cuzco (Pérou)
l’illustre l’expansion de Cuzco au Pérou dans un couloir intra-montagneux devenu trop
étroit » (Veyret, 2003 : 66).
C’est ainsi l’ensemble des habitants de la ville qui subit les conséquences d’une expansion
urbaine non maîtrisée depuis cinquante ans : la principale desserte longitudinale de la ville,
l’avenida de la Cultura, « coincée » dans une cuve montagneuse avec des voies secondaires
(transversales notamment) sans continuité, est régulièrement inondée, ce qui rend les secours en
cas de catastrophe extrêmement difficiles. Les quartiers de la zone moderne, pour les mêmes
raisons de problème d’évacuation des eaux, sont régulièrement affectés par les crues (Carreño,
1994 : 32).
2. Le raprochement fam ilial en périphérie, au « prix »
d’un risque plus grand
Dans les années 1960, les ordres religieux, franciscains et dominicains, vont s’avérer être les
principaux promoteurs fonciers dans l’expansion urbaine de Cuzco à l’est, le long des pentes. La
Asociacion Pro-Vivienda Los Incas va ainsi apparaître en 1963, sur des terrains qui appartenaient
aux Dominicains. Fortunato est un des premiers occupants, et le plus ancien encore présent dans
le quartier. Il nous raconte son installation à Los Incas :
« Los Incas a été fondé en 1963. Celui qui lotissait s’appelait Edgard Mostajo Sánchez,
il était avocat. Il vendait par lots, faisait des annonces à la radio. Aujourd’hui nous
sommes 650 familles à Los Incas. Nous avons nivelé par ici, c’était de la terre friable. J’ai
été le quatrième à m’installer ici. En 1962 j’ai rencontré ma femme, elle était de mon
village, Acumayo. Là-bas j’allais démarcher à Maldonado, en chargeant du verre pour
les travailleurs de l’or dans les mines… Pendant douze ans, en passant par le fleuve, les
montagnes ; deux jours de chemin, pour m’y rendre. En 1963, on s’est mariés, et on est
venus vivre ici. On a d’abord vécu à Huayrurupata, et les gens nous ont informé qu’il y
avait un quartier avec des terrains à acheter, parce que louer ça coûte. Il y en a de deux
cents, trois cents mètres carrés. Avec un ami, on a acheté ce lot, la moitié chacun, mais il
y a eu une dispute. Il voulait tout accaparer et me virer. Nous sommes allés voir Mostajo,
et il nous a divisé le terrain. Par la suite, je lui ai demandé de me connecter à son système
d’évacuation des eaux, mais il n’a pas voulu. J’ai dû faire ma propre connexion. Ensuite,
après que mes parents soient morts, ma sæur de Acumayo est venue dans l’année. Elle
m’a dit : ‘ Tu as déjà une maison, trouves-moi un terrain ’. Je suis allé demander pour
elle. Mon frère aussi, il a quitté Lima pour venir vivre ici, avec sa famille. Il est d’abord
venu vivre dans ma maison dans les années quatre-vingt, et après trois ans, je lui ai dit :
‘ tu ne peux pas rester là tout le temps. Tu dois te chercher un terrain ’. De là, il est parti
vivre à Garci Laso » (Fortunato, comité 6/ APV Los Incas, 31/03/04).
Garci Laso est un quartier contigu au comité 6 (Los Incas). D’un quartier à l’autre, les membres
d’une même famille se sont étendus, à l’image de Fortunato, de son frère et de sa « soeur » (il
s’agit en fait d’une cousine à lui), créant ainsi des réseaux sociaux favorisant la communication :
une porte, en effet, reliait les parcelles des deux frères entre Los Incas et Garci Laso. Lorsque
les glissements de terrain de 2001 et 2002 se sont produits dans le comité 6, ces « passages »
furent particulièrement mis à profit entre voisins et membres d’une même famille, situés sur
des parcelles contiguës. Mais par crainte de vols, ou de viol de leur intimité, les propriétaires
de ces passages préférèrent ensuite les fermer. Ainsi, la catastrophe peut dans un premier temps
resserrer les liens qui s’étaient construits sur plusieurs années, pour ensuite les défaire. Les
réseaux d’entraide mis en place à l’échelle de la parcelle entre les pionniers peuvent également,
après rupture, amener aussi à cette construction du risque, par la multiplication de connections
en alimentation/évacuation des eaux que cela implique, comme l’évoque Fortunato suite à
la division qu’il opéra avec son ami de la première heure à Los Incas. Ainsi, la catastrophe
est préparée bien avant qu’elle n’ait lieu, par la rupture de réseaux sociaux qui multiplie les
268
Nicolas Rey
incohérences sur le plan technique (connections au système d’alimentation/évacuation en eau).
Dans le même temps, la catastrophe peut rompre des réseaux d’entraide qui fonctionnaient
avant le désastre, depuis l’installation dans le quartier.
Comme les « pionniers » qui sont arrivés les premiers dans le quartier il y a quarante ans tel
Fortunato, aujourd’hui encore on quitte les localités plus rurales pour rejoindre les autres membres
de la famille, déjà installés en ville. Ce départ « s’organise » également comme autrefois : après
s’être marié, on part à deux s’installer en ville pour mieux l’affronter, pour y chercher le mieux
vivre et y fonder une famille. Les nouveaux venus sont alors dépendants du parent propriétaire de
la parcelle. Le témoignage ci-dessous de Jesusa est particulièrement instructif lorsqu’elle évoque
le contrôle social exercé sur elle par la famille de son mari chez qui elle est venue s’installer.
Cet informateur se livre à une comparaison avec son ancien quartier de résidence, Rosas Pata,
situé dans la ville plus formelle. Elle considère qu’elle avait plus de liberté « en ville » que dans le
quartier périphérique de Los Incas où la famille de son mari et les voisins surveillent ses moindres
faits et gestes. On a là un contrôle social qui va aller croissant de la part de sa belle-famille, en
fonction de ses installations successives à Cuzco dans différents quartiers :
« Je viens de Ollantaytambo, où mes parents et mes frères faisaient de l’agriculture. J’ai
vécu avec mon amoureux dès quatorze ans, et à seize je suis allée vivre à Huancaro, avec
mon époux. C’était un mauvais quartier. Il y avait de nombreux voleurs qui rentraient
dans les maisons, qui t’attendaient au tournant, te volaient tes vêtements. C’était comme
ça. Quand il pleuvait, il y avait de la boue partout. L’eau sale du fleuve rentrait dans les
maisons, les humidifiait, et après quelques années, elles tombaient.
Il y a huit ans, nous nous sommes installés à Rosas Pata. C’était mieux parce qu’il y avait
le marché à côté. La propriétaire était la tante de mon époux et elle nous faisait payer
moins cher. C’était pratiquement dans le centre de Cuzco, plus sûr, il n’y avait pas de
voleurs. La maison était plus grande qu’à Huancaro, il n’y avait plus de boue dans les
rues, c’était près des voitures. A Huancaro on avait une pièce, alors qu’à Rosas Pata
on avait une pièce et une autre plus petite pour la cuisine… c’était plus pratique pour
l’enfant, qui avait cinq ans, et plus prêt de l’école. Et mon époux était plus près de sa
famille, à Rosas Pata.
Puis on est passés à Los Incas, il y a cinq ans. Car ici on ne paie pas de location, c’est
la maison de ses parents. Ici nous avons trois pièces : une pour nous, une autre pour
le garçon de treize ans et la fille de neuf ans, et la cuisine. Dans toute la maison [la
parcelle], il y a trois familles en plus : mes belles-soeurs avec leurs époux et leurs enfants.
En venant m’installer ici, je l’ai très mal vécu, parce que ma belle-soeur est très méchante
avec moi, elle m’insulte : ‘ chèvre, chienne ’… Elle ne voulait pas que je sois avec son
frère. Elle voulait qu’il vive avec une amie à elle… Parfois quand il y a de l’eau, elle
ne me laisse pas en prendre. Comme mon mari n’est jamais là, il ne sait pas tout ça.
Également pour l’électricité, parce que eux ils l’utilisent plus avec tous leurs appareils :
ils ont un réfrigérateur, alors je ne veux pas payer la moitié de l’électricité avec ce qu’ils
utilisent… Je vivais plus tranquille à Rosas Pata, je sortais à n’importe quel moment, mais
ici, tout le monde t’observe, à quelle heure tu sors, ce que tu manges… » (Jesusa, comité
6/ APV Los Incas, 31/03/04).
Le parcours résidentiel de Jesusa est très instructif, car il fait apparaître comment chaque
installation auprès de la famille se fait en fonction de critères bien précis :
• chercher un plus grand confort, plus d’espace (on gagne une pièce à chaque déménagement)
au fur et à mesure que s’agrandit la famille ;
• ne plus avoir à payer de location.
Mais ce que l’on gagne en espace habitable et en économies, se paie au prix :
• d’un contrôle social plus fort exercé par la famille étendue, qui peut se traduire aussi par un
accès aux services sur la parcelle (eau, électricité) accaparé par les propriétaires de la parcelle,
au détriment des nouveaux venus ;
269
La construction du risque urbain en périphérie nord-est de Cuzco (Pérou)
• d’un risque urbain et d’une vulnérabilité subies au quotidien (violence urbaine, maisons
menaçant de s’écrouler, etc.).
Qu’est-ce qui pousse pour autant les habitants d’autres localités à rejoindre Cuzco ? La ville de
Cuzco reste au centre d’un réseau urbain au niveau départemental très structuré. Au niveau de
la province de Cuzco, l’accès aux services de base (eau, électricité) mais aussi l’alphabétisation
notamment des femmes, sont deux à trois fois supérieurs à la moyenne nationale, et devancent
de loin les autres provinces8. On quitte donc facilement les autres provinces du Pérou, mais aussi
l’intérieur de la province de Cuzco, pour rejoindre cette ville centre, plus attractive :
« Cuzco (…) s’est affirmée comme le centre politico-administratif et économique,
atteignant 24,2 % de la population totale départementale et 54,6 % de la population
urbaine départementale en 1993 (…). Cuzco : c’est le centre et l’intermédiaire de
presque toutes les dynamiques départementales. Sa hiérarchie politico-administrative,
ses fonctions commerciales et financières, ainsi que sa longue histoire d’articulation
aux niveaux régional et extrarégional, ont favorisé la concentration de services et l’ont
converti en un grand pôle attractif à tous les niveaux, au-delà de ses seules fonctions
marchandes. Cela a été renforcé par le flux aérien soutenu par le potentiel touristique
régional, et en relation avec Lima, avec le marché et le centre politico-administratif
national » (Hurtado & Puerta, 1995 : 11).
Mais une fois installés dans les périphéries, les nouveaux arrivants attirés par les lumières de la
ville, peuvent déchanter. En effet, les conditions d’accès aux services pour les plus pauvres, que ce
soit en périphérie de Cuzco ou dans le centre historique, ne sont pas meilleures que les chiffres
avancés à l’échelle nationale. D’après Riofrio (1996), les conditions de pauvreté et le manque de
services (eau), touchent autant les pauvres installés dans les constructions coloniales et modernes
du centre historique, que ceux ayant rejoint les zones à risque des périphéries, où les voies
carrossables manquent cruellement. On rejoint donc la famille pour avoir de plus faibles coûts en
logement et parfois plus d’espace, mais au prix d’un accès aux services limité et d’une exposition
au risque élevée. Comme le souligne D’Ercole (1991) pour la ville de Popayán, en Colombie — qui
connut un séisme à la suite duquel les pentes furent également comme pour Cuzco colonisées par
les exclus du logement social ou du secteur capitaliste — le risque social est bien plus obsédant
pour ces habitants, que le risque naturel. Et cet auteur d’ajouter (1991 : 452) que la vulnérabilité
« n’est pas seulement liée aux conditions économiques et sociales, mais aussi à la manière dont les
gens perçoivent le risque sismique ». Après enquête auprès d’habitants de Popayán9, le sentiment
de sécurité qui se dégage est « trompeur » et constitue un facteur de risque en cas de nouvelle
catastrophe ; en revanche cet optimisme n’est pas partagé par tous, notamment par les habitants
les plus modestes. Si ces derniers dans leur quartier ne se sentent pas menacés, ils craignent dans
le même temps les conséquences d’une nouvelle catastrophe à Popayan. Mais les habitants des
zones qualifiées « à risque » ont aussi une représentation du risque qui est d’ordre stratégique ; ils
savent habilement en faire un élément de pression sur les autorités dans leur confrontation pour
l’occupation des rares zones disponibles : les secteurs en pente.
3. « Cult ure » du risque contre immobilisme des
autorités
Dans la partie basse du comité 6/APV Los Incas, la plus touchée par les glissements de terrains
successifs d’avril 2001 et janvier 2002, les enfants préfèrent emprunter les chemins de traverse
8 Selon les recensements nationaux de population et de logement de 1993 (INE), Cuzco s’élevait au premier rang
pour l’accès à l’eau, à l’électricité, et pour l’alphabétisation des femmes, avec des taux avoisinant les 90 %, contre
des moyennes nationales respectivement d’environ 45 %, 25 % et 65 %.
9 Réalisée par D’Ercole, avec l’appui du BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières), d’Ingeominas et du
Sena de Popayán. Presque tous les habitants enquêtés considèrent que la ville est mieux préparée à affronter un
nouveau séisme, pour des raisons essentiellement techniques (maisons reconstruites, réparées et consolidées).
270
Nicolas Rey
entre les pans de murs effondrés et les tuyauteries éventrées, plutôt
que de suivre les circuits tracés autour du vide laissé par la partie
écroulée. Ils « jouent » à se faire peur, en repoussant les limites du
danger. Mais est-ce uniquement, un jeu d’enfant ?
Durant ces événements, les habitants sont restés jusqu’au dernier
moment dans leurs maisons : lorsque les murs ont commencé à
s’effriter et à se lézarder, et que les vitres se sont fendillées, ils ont
enfin décidé d’évacuer leur logement. Par la suite, ils sont revenus
s’installer dans leur maison éventrée, en se plaçant en retrait des
pièces situées en équilibre instable au-dessus du vide. Pour eux, il
est hors de question de quitter le seul bien qu’ils possèdent, leur
maison, fut-ce jusqu’au dernier moment… Le fait de vivre dans un
lieu constamment menacé, et souvent affecté par la catastrophe,
peut aussi amener une accoutumance, qui se traduit par une réponse
de moins en moins efficace pour faire face au désastre, avant, ou
pendant qu’il se produit :
« L’évaluation postcatastrophique est sans doute un des moyens les
plus efficaces pour comprendre le passage du risque à la catastrophe,
et donc proposer des mesures de prévention. (…) ce sont les études
postcatastrophe qui ont révélé les lois concernant l’accoutumance au
danger ; ces rapports montrent aussi la perte de mémoire classiquement
observée des usagers et des décideurs. Voici ce qu’écrivait en 1890 un
officier de l’instruction publique, Henry Vaschalde, à propos des crues
et inondations en Languedoc : ‘ Plusieurs années se passent sans qu’il
y ait de crues ; la confiance revient ; les maux passés sont oubliés, et
chacun s’empare du domaine des eaux jusqu’à ce qu’une inondation
comme celle du 22 septembre vienne détruire tous les travaux exécutés ’ » (Dauphiné,
2001 : 252-253).
Mais peut-on mettre en cause uniquement l’inconscience, ou la perte de mémoire ? Dans
des conditions extrêmes d’existence, les habitants vivent au jour le jour, sans avoir toujours
le luxe de pouvoir se projeter dans l’avenir. Dans les villes des pays en développement, que
ce soit le long des pentes abruptes, ou près des cours d’eau comme à Lima (cf. exemple cidessous),
le désastre rend les pauvres encore plus pauvres au quotidien (Maskrey, 1989) : les
habitants ressortent encore plus vulnérables d’une première catastrophe, cette vulnérabilité en
augmentation préparant les conditions d’un deuxième désastre, pouvant alors être plus ample.
Catastrophe après catastrophe, les habitants sont donc de plus en plus vulnérables et exposés à
de nouveaux désastres :
« Les inondations (…) affectent principalement les familles à bas revenus, qui ont les
capacités de réponse les plus faibles et dont les conditions de vie sont celles d’un état
d’urgence permanent, caractérisé par le manque d’eau potable, un habitat précaire et
des revenus bas et instables. Dans ces cas là, les effets des (…) inondations ne sont qu’un
aspect d’un désastre quotidien et permanent. Les catastrophes dans la vallée du Rímac
représentent une dégradation continue de la vie de la population. La destruction de
leurs maisons, la perte de leurs biens et l’interruption de leurs activités économiques
augmente leur vulnérabilité. Sans la possibilité de retrouver de nouvelles zones sécurisées
pour vivre, les gens reviennent occuper les secteurs dangereux » (Medina, 1994 : 273).
Si le désastre est social, la pauvreté en est le facteur le plus agissant. Et plus on est pauvre, plus
la catastrophe annoncée sera amplifiée. En 2003, dans le cas du quartier Chocco, en périphérie
sud-est de Cuzco, certains habitants qui avaient disposé leurs maisons au milieu du lit naturel
d’écoulement du fleuve, ne purent réagir rapidement pour s’échapper lors de la soudaine
montée des eaux. Le coût humain n’est jamais considéré par ces occupants de l’extrême, car
nous sommes dans une dynamique de survie au jour le jour, empêchant de se projeter bien loin
Figure 4 – Zone sinistrée du quartier Los
Incas. Une fillette « joue » avec le risque,
à l’entrée de ce qu’il reste de la maison
familiale suite aux glissements de terrain
de 2001 et 2002 (photo : Rey)
271
La construction du risque urbain en périphérie nord-est de Cuzco (Pérou)
dans l’avenir (un toit et manger chaque jour sont les seules prérogatives qui font force de loi). Il
faut aussi bien prendre en compte le fait que les derniers migrants, arrivés récemment dans ces
zones, sont aussi les moins avertis face aux catastrophes, et ce, pour deux raisons :
• tout d’abord, ils s’installent là où il y a encore de la place, donc le plus souvent, dans les zones
les plus ingrates, et les plus dangereuses, qu’on leur réserve (la communauté préfère en effet
se garder les terrains mieux situés, pas forcément les plus chers) ;
• la seconde raison est qu’ils n’ont pas encore pu mesurer la temporalité et l’intensité des
catastrophes potentielles. Cette information peut d’ailleurs ne pas être divulguée par les
responsables communautaires, au moment de la vente. Ainsi, à Chocco, un migrant arrivé en
2003 acheta son terrain près du fleuve traversant le quartier, sans se douter de la gravité du
danger qui le menaçait. Dans l’année de son achat, sa maison et ses biens furent emportés par
les crues.
Aujourd’hui, à Los Incas, trois maisons sont en équilibre instable au-dessus du vide. Parmi ces
occupants, deux familles ont acheté leur maison il n’y a pas plus d’une dizaine d’années : les
derniers arrivés, pas forcément les plus pauvres, sont en tout cas les plus mal lotis face au risque.
Le temps de l’expérience et les réseaux d’information sont donc des données fondamentales à
considérer dans la construction du risque. Comment les habitants de ces secteurs les plus touchés
par les glissements de terrain en 2001 et 2002, et menaçant de s’effondrer à tout moment, ont-ils
vécu la catastrophe, et pourquoi reviennent-ils s’installer là ? Julio, un de ces habitants en sursis,
nous relate les événements du 24 janvier 2002, qui ont affecté son foyer :
« Je ne peux pas partir, car mes enfants vont au collège à côté, donc pour le transport, je
préfère rester ici. La moitié de ma maison est fendue. La fissure n’a pas progressé après
l’effondrement. La porte ne se ferme pas bien. Mais ici, le problème c’est l’eau. Si on me
reloge avec l’eau là-bas, moi je partirai. Les autres à côté, ils ne veulent pas partir. Mais
moi je ne peux plus vivre là, la maison glisse, il peut y avoir un tremblement de terre. En
fait, il y avait un tuyau sous la terre qui s’est cassé, donc on voyait juste la sortie d’eau en
surface mais on ne voyait rien en dessous. Si on avait réglé ça… ça fait cinq ans que par
en dessous ça travaillait, et pire lorsque la pluie est arrivée : ça s’est mélangé avec cette
poche d’eau d’en dessous. On s’est rendu compte de ça après le glissement de terrain.
Pour l’éboulement de 2002, c’était dix heures du soir, le vingt-quatre janvier. Mais un
jour avant j’avais déjà remarqué que le chemin était fissuré, et la nuit, tout un bloc est
parti. C’était l’anniversaire de ma fille ce jour là, pour ses vingt ans. Elle était venue fêter
son anniversaire avec son mari. Finalement, elle est restée trois jours, car la situation était
désespérante. On était dans l’expectative, si quelque chose se passait, prêts à courir.
L’éboulement, ça a fait comme un volcan, les pierres, le bloc avec les escaliers… Les gens
situés plus bas, à Los Portales, sont sortis en hurlant lorsque toute cette masse a défoncé
leur mur. Les plus petits chez moi dormaient, les plus grands étaient en train d’observer.
On avait prévu de sortir par derrière par les escaliers, pour aller chez le voisin : par là
on a sorti nos affaires, le lendemain [de la catastrophe]. Le lendemain, la police nous a
dit à tous qu’il fallait libérer les lieux et se transférer ailleurs. Un de mes fils est revenu
s’installer dans la maison pour la surveiller, il ne voulait pas rester dans la maison louée
plus haut. ‘ Ah si elle tombe, qu’elle tombe ’, il disait… » (Julio, comité 6/ APV Los Incas,
09/03/04).
L’analyse du témoignage de Julio révèle plusieurs choses. Le statut de résidence principale, la
présence sur place, et l’ancienneté de la propriété, sont mis en avant pour bénéficier d’une
intervention extérieure afin d’être relogé. À cela vient se superposer le fait que les voisins immédiats
de Julio déclarent ouvertement qu’ils ne veulent pas être relogés ailleurs… Julio cherche donc
ostensiblement à se démarquer d’eux, en remettant en cause les revendications de ses voisins
qui, ayant racheté à sa famille leur terrain et leur maison, ne sont pas en mesure légitimement
selon lui d’imposer leur point de vue, au nom de tous. Il y a donc une différenciation sociospatiale
très forte, au sein même du secteur touché par la catastrophe, qui détermine l’attitude
de chacun, face au risque.
272
Nicolas Rey
Les rares interventions des habitants pour réduire le risque, peuvent même prêter à sourire :
on dispose des planches sans les fixer, contre le mur du voisin situé plus haut, prêt à tomber...
Il n’y a donc pas de réelle prévention du risque, mais plutôt une gestion dans l’urgence : la
mitigation (réduction du risque) durable serait-elle absente des consciences ? Il semble que les
habitants soient tout à fait conscients du risque qu’ils encourent. Leur « inaction » ne traduit pas
une inconscience avérée ; au contraire, elle est une stratégie visant à faire réagir les autorités. Le
manque d’attention que portèrent les hommes envers la Pacha Mama, la Terre Mère, lorsqu’ils
urbanisèrent les quartiers périphériques, est également une explication avancée par certains
habitants du quartier Los Incas, concernant les glissements de terrain qui se sont succédés. Le
terme pachakuti, traduit aussi par « retour de la terre » à travers ces glissements de terrain, est alors
évoqué, comme une réaction de la Pacha Mama… En Bolivie, ces termes ne sont plus connus de
la population indienne. Ils seraient cependant réinvestis par les leaders communautaires et/ou
des anthropologues développant un discours indigéniste, notamment en milieu urbain :
« Dans la société aymara, le juicio marque la fin d’un cycle et le début d’un autre. Ce
bouleversement qui verra l’apparition d’une nouvelle humanité est interprété comme une
inversion entre le monde du haut et le monde du bas (Harris, 1989), idée exprimée dans
les documents anciens par le terme pachakuti, aujourd’hui inconnu des paysans rencontrés
mais repris depuis peu dans les discours indianistes urbains » (Rivière, 1996 : 93).
Cette culture du risque semble avoir un objectif sous-jacent, et elle représente l’ultime issue pour
les habitants, afin de faire pression sur les autorités : tout est fait comme s’il fallait en rajouter un
peu plus à une situation déjà extrême, pour attirer l’attention de façon directe et sans détours, sur
les conditions de vie « invivables » de ces habitants. Dire qu’ils en jouent n’est pas un vain mot.
Lorsque les mères balancent leurs enfants de cinq ans à bout de bras au-dessus du vide, en les
faisant pleurer, peut-être est-ce pour leur apprendre à dompter la peur de leur condition, pour
mieux y faire face, ou encore pour m’interpeller, moi l’étranger, représentant à leurs yeux des
ONG et autres organismes internationaux, capables d’intervenir sur ces secteurs ?… Les premiers
mots qui me furent adressés par certains de ces habitants furent d’ailleurs : « vous voulez parler
avec nous pour quoi faire, pour nous aider ? »
De plus, les enfants montent les échelles reposant sans y être fixées sur des planchers flottant au-dessus
du vide, sans armatures les reliant à la pente ; ils sont envoyés également plus bas par les parents
qui les ignorent alors ostensiblement du regard, pour ramasser les ustensiles — seaux, vaisselle, linge
— tombés dans la pente, dans des endroits inaccessibles… un faux pas, et c’est la chute dans le
précipice formé par l’effondrement de l’escalier qui se trouvait là, avant la catastrophe.
Enfin, aucun escalier de rechange, même de fortune, n’a été reconstruit par ces habitants, qui
chaque matin, chaque midi, chaque soir, font le va-et-vient entre chez eux et l’extérieur, au péril
de leur vie…
Qu’attendent-ils d’ailleurs, au juste ? Avril 2001, avril 2004… après maintenant trois ans qu’a eu
lieu le premier drame, et autant de temps de promesses non tenues par les autorités, que peuvent
encore espérer les habitants comme amélioration de leur condition au quotidien ? « Après les
pluies, nous commencerons les travaux », leur répètent les autorités, comme un leitmotiv. Les
élections passent, et aux promesses électorales succède l’inaction, après le résultat des urnes. Les
autorités intervenant sur la zone sont toutes d’accord pour l’évacuer, mais chacune apporte une
réponse différente au problème posé.
La municipalité de Cuzco et le Ministère du Travail sont associés à travers le projet a trabajar
urbano qui consiste dans la zone nord-est de la ville à consolider la zone, avec la construction à
Los Incas d’un mur de contention qui est systématiquement reportée. Les dissensions politiques
entre le gouvernement et la mairie sont d’ailleurs souvent avancées par ces deux acteurs pour
justifier l’absence de prise de décision10. Chacun se renvoie donc la balle, et pendant ce temps,
10 Le premier des deux acteurs (le Ministère du Travail), « tolediste », du parti du président de la république de
l’époque, accusant le second (la municipalité de Cuzco) — et vice-versa — d’être affilié à l’autre bord politique,
celui de Fujimori (ancien chef de l’État péruvien).
273
La construction du risque urbain en périphérie nord-est de Cuzco (Pérou)
les lignes budgétaires tant au niveau de la municipalité, que du gouvernement, ont été utilisées
à d’autres fins. En 2004, le Ministère du Travail a pris prétexte des fortes pluies qui ont affecté le
sud du Pérou pour justifier à nouveau du report des travaux sur Los Incas.
Pour la Défense Civile décentralisée (région de Cuzco), la zone doit être évacuée. Ses ingénieurs
déclarent cependant qu’une fois la zone consolidée par le projet a trabajar urbano, certains
habitants seront alors convaincus que la zone aura été débarrassée de tout risque possible.
On constate donc que la politique de décentralisation menée par l’État rencontre des
contradictions très fortes au niveau local, entre les décisions prises par ses services au niveau local
(Defensa Civil de Cuzco), la municipalité, et les ministères. La décentralisation fut même, sous
Fujimori, mise au service « du chef », déstructurant l’action collective et rendant les structures de
quartier encore un peu plus dépendantes :
« Dès son arrivée à la présidence, A. Fujimori institue une extrême personnalisation du
pouvoir. Les fréquentes visites qu’il effectue dans les barriadas en témoignent. Cette
personnalisation du pouvoir, qui se manifeste par l’instauration de relations directes et
clientélistes avec les pobladores, s’observe dans plusieurs domaines. En premier lieu,
l’organisation administrative que le chef de l’État institue, et dont l’exemple le plus
significatif est le ministère de la Présidence. Ensuite, la politique de démantèlement des
structures d’action collective avec l’exemple du programme du verre de lait. (…) Au
début des années 1990, l’obtention d’un service collectif, par exemple au bureau de la
voirie, exige des démarches précises : soixante familles au minimum, et appartenant au
même district, doivent se réunir afin de présenter leur revendication et de solliciter un
crédit. Cette demande s’adresse au ministère de la Présidence, qui finance directement
le projet. Ainsi, le poblador peut associer directement la construction d’une infrastructure
à l’image du président » (Burgos, 2000 : 108-109).
Conclusion
Comme développé dans cet article, l’absence de volontarisme politique dans le domaine
de la planification urbaine depuis le tremblement de terre de 1950 à Cuzco, ou le caractère
contradictoire de certaines décisions prises par les autorités suite aux glissements de terrains se
succédant depuis les années 1980 en périphérie nord-est de la ville, sont générateurs pour les
habitants d’augmentation et du risque, et de la vulnérabilité. Dans le même temps, devant cette
défection des pouvoirs publics, les habitants se sont rassemblés en associations pour organiser
leur logement, avec de faibles moyens. Ils sont tombés dans le marché de la ville illégale, en
s’installant dans les seules zones disponibles, à savoir les plus dangereuses (le long des pentes
abruptes ou des courants d’eau en crue dès la période des pluies), sans respect des normes de
construction en matière d’alignement de voirie, de système de drainage, ou de résistance des
matériaux dans une région à forte activité sismique. Une véritable « culture » du risque va alors
se développer, mêlant à la fois au premier abord résignation face à un destin qui s’acharne, voire
attitude de trompe-la-mort, comme pour provoquer un peu plus la providence, ou encore retour
à des croyances se réclamant du passé incaïque. En effet, face à l’action des hommes « modernes »
pris dans le modèle urbain occidental dominant, la Terre (la Pacha mama) et les ancêtres incas
morts pour préserver ce territoire contre l’expansion coloniale espagnole, se vengeraient, en
réagissant de façon violente à travers les catastrophes frappant la ville (crues, glissements de
terrain). Peut-on se contenter cependant d’une explication de type fonctionnaliste ou culturaliste
pour appréhender dans sa complexité la construction du risque dans cette ville andine ?
De plus, l’après catastrophe sans union pour faire face aux problèmes quotidiens qui affectent
tous les habitants (le quartier n’en finit pas de s’affaisser après les glissements de terrain survenus),
et l’abandon de l’action collective pour se replier sur la famille, sont propices à une augmentation
sensible de la vulnérabilité de chacun. Cette vulnérabilité s’est accentuée suite au détournement
par certains représentants de quartier de fonds alloués par les habitants pour les travaux d’ordre
274
Nicolas Rey
général. Le « pourrissement » de la situation est ainsi renforcé, plongeant un peu plus le secteur
effondré, vers une nouvelle catastrophe. Les habitants seraient-ils à ce point inconscients en
laissant leur quartier tomber en ruine ?
Sur le terrain du quartier Los Incas, lorsque l’espoir s’est encore un peu plus éloigné en avril
2004 de voir s’améliorer la situation par une intervention des pouvoirs publics sur la partie
affectée (glissements de terrain de 2001 et 2002), on peut observer qu’individuellement,
certains habitants sont intervenus alors eux-mêmes pour prendre enfin en charge un minimum
de travaux d’amélioration. Après que les habitants aient été informés du nouveau report du
projet de consolidation de leur secteur effondré, certains parmi les plus menacés ont amorcé des
travaux d’amélioration :
• les uns ont fermé avec des planches le terrassement qui marquait l’entrée de leur maison, où
les enfants jouaient, au-dessus du vide ;
• les autres ont creusé dans la pente quelques marches, permettant ainsi de remonter dans les
maisons en équilibre instable, en limitant les risques de faire une mauvaise chute.
L’inaction des habitants n’était donc qu’un leurre, destiné à faire pression sur les autorités…ou
comment l’inaction est, de fait, action ! Dire que les habitants de ces quartiers ne sont pas
conscients du risque qu’ils encourent, c’est faire totalement fausse route, sans voir les stratégies
cachées mais inhérentes, à leur attitude, jugée par d’aucuns, passive. Quant à la prévention, ce
n’est pas à eux, mais aux autorités, de l’assumer. Il y a en réalité une conscience très aiguë du
risque chez les habitants, et leur inaction de façade amenant un pourrissement de la situation
(maisons qui tombent en ruine) est de fait, après analyse et recontextualisation, une action des
plus volontaristes qu’il soit, pour précisément amener les autorités à prendre leurs responsabilités,
à terme. Et si l’on peut sortir de la situation de confrontation entre pouvoirs publics et autorités,
peut-être sera-t-il alors temps d’envisager le rapatriement des pratiques préventives populaires
acquises au fil du temps par les habitants, vers les secteurs décisionnels :
« De tout temps, des systèmes d’entraide communautaire plus ou moins institutionnalisés,
tel que le gotong royong dans les kampungs de Djakarta, ont permis d’éviter bien des
victimes dans des incendies ou des inondations. Cette réalité sociale apparaît comme
un élément très positif à partir duquel les autorités publiques sont tentées d’utiliser ces
réseaux traditionnels pour ‘ apprivoiser le risque ’. L’idée est d’informer et d’accoutumer
les populations au risque et de créer de ‘ bons ’ réflexes. (…) Il a souvent été remarqué
que la pauvreté, la densité, les problèmes spécifiques liés à la gestion et l’absence
d’accès à certains outils techniques accentuent la vulnérabilité des villes du sud, alors
que peut-être, à l’inverse, ces dernières possèderaient une spécificité en matière de
réponse sociale à la crise (…) » (Milbert, 2003 : 325).
Pour l’heure, le risque demeure un enjeu politique entre habitants et autorités, construit avant,
pendant et après la catastrophe. « Action » et « inaction » sont donc à recontextualiser de façon
très précise, en fonction des enjeux et intérêts sous-jacents voyant s’opposer les différents
acteurs intervenant sur la zone sinistrée. D’un côté, la démarche de l’anthropologue vise alors
à comprendre comment le « traditionnel » est instrumentalisé par les habitants, pour amener
les autorités à réduire le risque. La culture du risque en étant étudiée en fonction du système
de croyance propre aux sociétés andines, ne doit donc pas tomber dans le piège de l’assessorat
ethnique. De l’autre, il s’agit de percevoir comment le risque naturel peut être instrumentalisé
par les autorités, afin d’entretenir une dépendance entre administrés et leurs représentants.
Cette dépendance repose sur une politique de l’urgence : on n’intervient qu’après-coup, une
fois la catastrophe passée. La vulnérabilité des habitants est telle qu’ils ne peuvent refuser tout
type d’aide, aussi minime soit-elle, afin de panser les plaies du désastre. Cette relation clientéliste
entre habitants et élus, construite durant les décennies d’installation le long des laderas, est
finalement consolidée une fois la catastrophe réalisée : culture du risque chez les habitants contre
immobilisme par l’action contradictoire des autorités, ne font que perpétuer un tel système.
275
La construction du risque urbain en périphérie nord-est de Cuzco (Pérou)
Si l’on souhaite appréhender au plus près ces enjeux qui opposent habitants et autorités,
entre représentation du risque dans les secteurs menacés et intervention des pouvoirs publics
dans l’espace urbain et péri-urbain, le recours à une approche de type socio-spatiale, offre
des outils d’analyse permettant de mieux cerner la construction du risque dans sa complexité.
L’approche sociologique, développée brillamment depuis les années 1980 par les chercheurs du
réseau latino-américain La Red, emmenés notamment par Maskrey, a évolué récemment vers
une méthodologie de type microsociologique ou anthropologique, avec la constitution d’une
véritable anthropologie des catastrophes, notamment à travers les travaux d’Oliver-Smith (2002)
ou encore de Stein (2002). Et les recherches menées par les géographes français dans les années
1990 (D’Ercole, Thouret, Chardon, etc.), ont eu le mérite d’articuler l’approche spatiale avec
celle plus sociale, du risque. Reste à la recherche sur le système risque de mobiliser davantage
les chercheurs européens, nord ou sud-américains, pour éviter qu’ils ne rejoignent le champ de
leurs recherches de prédilection (Lavell, 1993), après les grandes catastrophes11.
Références citées
Briseau , J., 1981 – Le Cuzco dans sa région : étude de l’aire d’influence d’une ville andine, 571
p. ; Lima : Intitut Français d’Études Andines. Série Travaux de l’IFEA, 16.
Burgos, D., 2000 – Villa El Salvador : un bilan de la participation politique. Problèmes
d’Amérique latine, n° 38 : 101-116.
Careño, C., 1994 – Risques naturels et développement urbain dans la ville andine de Cuzco,
Pérou. Revue de Géographie Alpine, n° 4, Tome LXXI : 27-45.
Centro Bartolomé de Las Casas, 2003 – Gobernancia y riesgos ambientales urbanos en Cusco ;
Cusco.
Chardon, A.-C. & Thouret, J.-C., 1994 – Cartographie d’une vulnérabilité de la population
citadine face aux risque naturels : le cas de Manizales. Mappemonde, 4 : 37-40 ;
Montpellier.
D’Ercole, R., 1991 – Vulnérabilité des populations face au risque volcanique, le cas de la
région du volcan Cotopaxi (Équateur). Thèse de doctorat ; Grenoble : Université Joseph
Fourier.
Dauphiné , A., 2001 – Risques et catastrophes. Observer, spatialiser, comprendre, gérer, 288 p. ;
Paris : Armand Colin.
Durand, G., 1970 – La banlieue est du Cuzco et son expansion contemporaine. Mémoire de
maîtrise de Géographie ; Paris : Université de Paris 8.
Hurtado , I. & Puerta , M., 1995 – Las tendencias del crecimiento urbano en el departamento
de Cusco. Crónicas Urbanas, 4: 5-16 ; Cusco : Crónicas urbanas.
Lavell , A., 1993 – Ciencias sociales y desastres naturales en América latina: un encuentro
inconcluso. In: Los desastres no son naturales (A. Maskrey, ed.) : 135-154 ; Bogotá: La red
de estudios sociales en prevención de desastres en Amérique Latina, La Red-Tecnología
intermedia. ITDG.
Marco Cortez, A., 1989 – La historia que no fue contada. ¿Quiénes le dieron al Cusco la
forma que ahora tiene ? Crónicas Urbanas, 1: 4-12 ; Cusco : Crónicas urbanas.
11 Cf. les tremblements de terre de Mexico, San Salvador, Guatemala, ou la catastrophe du Nevado de Ruiz, qui ont
mobilisé la communauté scientifique internationale (Colombie).
276
Nicolas Rey
Maskrey, A., 1989 – El manejo popular de los desastres naturales : estudios de vulnerabilidad
y mitigación, 208 p. ; Lima : ITDG.
Medina, J., 1994 – Experiencias de mitigación de desastres. In : Viviendo en riesgo : comunidades
vulnerables y prevención de desastres en América Latina (A. Lavell, ed.) : 267-282 ;
Bogotá: Facultad latinoamericana de ciencias sociales-FLACSO, Red de estudios sociales
en prevención de desastres en América Latina, La Red-Centro de prevención de desastres
naturales en Centro América. CEPREDENAC.
Milbert, I., 2003 – Vulnérabilité et résilience des métropoles : « elles sont si fragiles ». In :
Développement durable et aménagement du territoire (A. Da Cunha, ed.) : 313-
330 ; Lausanne : Presses Polytechniques et Universitaires Romandes.
Oliver-Smith, A., 2002 – Catastrophe and culture: the anthropology of disaster, 312 p. ; Santa
Fe: School of American Research Press.
Pirotte , C., Huson, B. & Grünewald , F. (eds.), 2000 – Entre urgence et développement,
pratiques humanitaires en question, 237 p. ; Paris : Karthala.
Quedena, E., Estrada, E., Apa za, D., Paredes, P., Arteaga, Y. & Quiñonez, L., 1994 –
Los retos del desarrollo agro-urbano, el caso de San Jerónimo-Cusco, 208 p. ; Cusco :
Centro Guaman Poma de Ayala.
RIOFRIO, G., 1996 – Lima: Mega city and mega-problem. In : The Mega-City in Latin America
(Gilbert A., ed.) : 155-172 ; Tokyo : The United Nations University Press.
RiviÈre, G., 1997 – Bolivie : le pentecôtisme dans la société aymara des hauts-plateaux.
Problèmes d’Amérique latine, 24 : 81
La construction du risque urbain en
périphérie nord-est de Cuzco (Pérou)
Nicolas Rey*
Résumé
Dans l’ancienne capitale inca, Cuzco, les pentes abruptes ont été colonisées par les habitants pauvres
n’ayant pas trouvé à se loger dans le centre-ville. Située dans une zone de forte activité sismique, Cusco
a ainsi vu ces dernières décennies deux types de catastrophes se succéder : le tremblement de terre,
comme celui de 1950, a déplacé la population vers les périphéries, qui se sont ensuite étendues sans
planification ; et depuis les années 1980, les glissements de terrain emportent les maisons en adobe
occupées en majorité par des populations indiennes et métis vulnérables. Face à l’urbanisation des
hommes, la Terre Mère, la Pacha Mama, ne serait-elle pas de retour, pour se venger ? Cet article montre
dans un premier temps comment une expansion urbaine non maîtrisée par les autorités a conduit
à la construction du risque en périphérie de Cuzco. On rentre ensuite dans le détail des stratégies
développées par les habitants quechuas et métis pour lesquels la recherche du moindre coût en se
logeant le long des pentes abruptes se fait au prix d’un risque plus grand en partie assumé. Enfin,
entre positions contradictoires des autorités selon les niveaux décisionnels (Defensa civil, mairie…), et
représentation du risque par les habitants renvoyant aux schèmes de la culture quechua, il s’agit alors de
confronter les différentes stratégies des acteurs face au risque pour espérer en améliorer sa gestion.
Mots clés : risques, quartiers périphériques, gouvernance, anthropologie, Cuzco
La construcción del riesgo urbano en la periferia noreste de
Cuzco (Perú)
Resumen
En la antigua capital Inca, Cuzco, las laderas fueron colonizadas por los habitantes pobres que no
encontraron donde vivir en el centro de la ciudad. Situada en una zona de fuerte actividad sísmica,
Cusco ha conocido dos peligros en las ultimas décadas: el terremoto de 1950 que provocó el traslado
* Docteur en sociologie du développement (La Sorbonne & IEDES) : 18, rue de la Tour, 77410 Villevaudé. E-mail:
nicolartiste@yahoo.com
260
Nicolas Rey
de la población hacia las periferias que se han desarrollado sin planificación y los derrumbes que desde
los años 1980 han destruido muchas casas de adobe ocupadas por indígenas o mestizos vulnerables.
Uno se pregunta si frente al proceso de urbanización que llevan a cabo los hombres, la Madre Tierra,
la Pacha Macha, no ha vuelto para vengarse. Este artículo demuestra cómo la expansión urbana no
planificada por las autoridades ha desembocado en la construcción en condiciones de riesgo en las
periferias de Cuzco. Luego se trata de entender en detalle las estrategias económicas desarrolladas por
los habitantes quechuas y mestizos que buscan alquileres más accesibles, pero que aceptan instalarse
en zonas altamente peligrosas como son las laderas, por falta de recursos. En fin, se trata de confrontar
las estrategias de los diferentes actores para mejorar la gestión del riesgo, frente a las contradicciones
de las diversas autoridades (Defensa civil, municipalidad...) y la representación del riesgo que tienen
los habitantes quechuas.
Palabras clave: riesgos, suburbios, gobernabilidad, antropología, Cuzco
The construction of urban risk in the north-east perifery of
Cuzco (Peru)
Abstract
In the ancient capital of the Inca Empire, Cuzco, the steep slopes have been occupied by poor
inhabitants who didn’t find anywhere to live in the city center. Localized in a zone of great seismic
activity, Cuzco has known two types of disasters in the last decades: earthquakes, like the one of
1950, that deplaced the population to the peripheries without planning; and landslides, which since
the 1980’s, destroyed the adobe houses occupied by a majority of indian and mestizo population.
Wouldn’t the Earth Mother, The Pacha Mama, come back, to exact revenge, after seeing the results of
men’s urbanisation? In the first part, this article explains how the uncontrolled urban expansion has led
to the construction of risk in the peripheries of Cuzco ; then, in the second part, we detail strategies
developed by the quechua-speaking inhabitants and mestizos who are looking for cheaper housing
prices on the high risk slopes ; finally, we examine examine contradictory positions of the authorities
at diferent levels ( civil defense, municipality...), and the representation of risk made by the inhabitants
within the context the quechua culture. We conclude by considering the strategies of the actors to
mitigate the risk and improve its management.
Keywords: risks, suburbs, governance, anthropology, Cuzco
Dans les villes de montagne latino-américaines, et en particulier andines, les glissements de
terrain se succèdent depuis plusieurs décennies dans les quartiers périphériques en pente.
Ces catastrophes surviennent dans le contexte socio-historique et politique suivant : crise du
monde rural et explosion urbaine après 1950, absence d’une planification capable d’organiser
l’expansion de la ville, classes populaires organisées en associations pour se loger, dans les
espaces restés libres, en général les plus ingrats, et régularisation après-coup par les autorités de
ces zones à risque, une fois que le « mal » a été fait.
La ville de Cuzco, située dans les Andes péruviennes, à 3 500 mètres d’altitude, n’échappe pas
à ces constantes.
261
La construction du risque urbain en périphérie nord-est de Cuzco (Pérou)
Jusque dans les années 1950, Cuzco, ancienne « capitale » inca, était principalement délimitée
par son tracé colonial. Cuzco était la ville la plus dense du Pérou : le phénomène dit de
tugurizacion dominait (surconcentration et dégradation des quartiers ainsi occupés). Il n’existait
alors pas de continuité urbaine entre le centre historique proprement dit, et les autres districts
plus éloignés1. Suite au tremblement de terre de 1950, qui ravagea plus de 3 000 maisons,
laissant sans toit de 30 000 à 40 000 personnes, Cuzco va s’étendre vers l’est. Mais ce début
de continuité urbaine se fera au prix d’une installation le long des laderas (pentes abruptes)
dominant la ville, sans planification urbaine. La municipalité de Cuzco va régulariser après coup
ces nombreux quartiers construits sur des terrains rachetés par les habitants aux ordres religieux
et aux grands propriétaires (hacendados).
Ainsi, en plus du centre historique, toujours menacé par l’activité sismique intense dans la région,
sont apparues le long des pentes de nouvelles zones à risque, nées de l’installation non contrôlée
d’habitants qui ont élaboré leur système de drainage et une trame urbaine sans cohérence avec la
ville plus formelle. Résultat : de nombreux glissements de terrains affectent régulièrement depuis
vingt ans la périphérie nord-est de Cuzco, emportant maisons et ruelles, dans la chute. Deux
glissements de terrain survenus respectivement en avril 2001 et janvier 2002 dans le secteur dit
« comité 6 » du quartier Asociacion Pro-Vivienda Los Incas2, provoquèrent la destruction de cinq
maisons, et endommagèrent deux autres constructions limitrophes. La rue centrale du comité
6, constituée d’un escalier, a également été emportée, pour moitié. En réponse, les autorités
s’accordèrent pour déclarer qu’il fallait évacuer la zone, mais leur absence de cohérence quant
aux actions à mener après la catastrophe ne firent que plonger un peu plus les habitants dans
une vulnérabilité déjà élevée avant même l’événement3.
L’exemple du quartier Los Incas, en périphérie nord-est de Cuzco, nous intéresse tout
particulièrement pour appréhender dans le détail ce qui, depuis maintenant plusieurs décennies,
a façonné cette construction du risque dans la ville andine. Plusieurs questions se posent alors :
• Comment historiquement, socialement, « urbanistiquement », les conditions amenant à des
glissements de terrain successifs dans la zone nord-est depuis les années 1980, ont-elles
été réunies, et quelles sont les parts de responsabilité des uns et des autres — habitants,
représentants de quartier, municipalité, État et services décentralisés ?
• Après la catastrophe, quelles réponses en matière de mitigation ont été apportées par ces
différents acteurs, et en fonction de quelles représentations du risque souvent opposées —
institutionnelle, « culturelle » — se positionnent-ils ?
Une double approche, à la fois anthropologique et urbanistique, permet d’apporter des éléments
de réponse.
Tout d’abord, on s’attachera à montrer comment à un type de catastrophe qui frappa le centre
urbain de Cuzco (tremblement de terre de 1950), est venue se greffer une autre menace :
le glissement de terrain, cette fois le long des pentes abruptes colonisées en périphérie. La
responsabilité des pouvoirs publics dans la construction historique du risque est ainsi retracée
dans le détail durant cette deuxième moitié du 20e siècle, à travers une présentation des choix
politiques faits en matière de gestion urbaine, face à la ville en expansion.
Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons aux parcours résidentiels des classes pauvres,
venues des campagnes environnantes ou plus lointaines (autres provinces), pour rejoindre la ville
1 Comme San Sebastián ou San Jerónimo, situés à l’est.
2 Le quartier Los Incas, apparu en 1963 en périphérie nord-est de Cuzco, est divisé en neuf comités.
3 Ces questions de gouvernance et de gestion du risque traitées dans le cas d’étude du quartier Los Incas, s’inscrivent
dans le vaste champ de recherche développé par l’Institut Universitaire d’Études en Développement et l’IP8
(Individual Project
recherche suisse NCCR North-South. Le Pérou, la Bolivie et l’Argentine sont les trois pays latino-américains
d’intervention de cette équipe pluridisciplinaire, dont les responsables Isabelle Milbert et Marc Hufty méritent ici
d’être chaleureusement remerciés. Cet article, résultat de deux mois d’enquête dans le quartier Los Incas au début
2004, fait suite à l’étude Gobernancia y riesgos ambientales urbanos en Cusco réalisée par le Centro Bartolomé de
Las Casas (2003), situé à Cuzco et coopérant avec l’IUED/IP8.
262
Nicolas Rey
de Cuzco, du centre aux périphéries. Nous pourrons constater alors que la recherche de plus
d’espace habitable et d’une réduction des coûts du logement en se regroupant dans la famille
étendue, l’emporte sur le « choix » d’une exposition plus faible au risque. Dans un contexte
de crise interne après la catastrophe, quand les relais au sein du voisinage entre habitants et
leurs représentants de quartier ne fonctionnent plus, l’action collective peut être abandonnée au
profit d’un repli sur la parcelle familiale.
Enfin, nous étudierons la représentation du risque spécifique que se font les habitants indiens
(quechua) et métis des périphéries urbaines, en fonction de leur rapport notamment à la
terre considérée comme divinité agissante. Dans cette optique, nous préférerons le terme
représentation à celui de perception. Comme le soulignent très justement Pirotte et al. (2000), la
notion de perception implique qu’il y ait un risque concret, seul capable d’être pris en compte,
opposé à un autre type de risque, plus imaginaire… Or, peut-on parler d’objectivité du risque ?
Le terme de représentation permet d’assumer la complexité de l’objet, en s’appuyant sur les
systèmes cognitifs spécifiques à chaque groupe étudié, en fonction notamment de leurs cultures
et croyances propres.
Pour espérer améliorer leur sort face aux glissements de terrain à répétition, les habitants des
périphéries en pente de Cuzco ont ainsi élaboré une « culture » du risque, particulière au contexte
socio-politique de cette région péruvienne. À partir de cette étude de la construction du risque
à Los Incas, dans la périphérie nord-est de Cuzco, au-delà d’une approche fonctionnaliste et
culturaliste du risque, il s’agit donc bien de montrer comment les habitants se sont organisés
face à une absence de volontarisme politique ou à des choix contradictoires chez les autorités
débouchant sur l’immobilisme. L’approche anthropologique et urbanistique est dès lors mise au
service d’une compréhension plus large des enjeux politiques entourant la gestion du risque,
dans la ville andine.
Figure 1 – Le Pérou et Cuzco,
capitale de l’empire inca
(élaboration : Rey según www.
americas-fr.com/geographie/
cartes/carte_perou.html - 24k)
263
La construction du risque urbain en périphérie nord-est de Cuzco (Pérou)
Figure 2 – Les quartiers « à risque » en périphérie nord-est de Cuzco (élaboration : Rey, según Salas del Pino et al., 1998)
264
Nicolas Rey
Figure 3 – L’expansion longitudinale de la ville selon le phénomène de « conurbation »
(d’après : Carreño, 1994)
265
La construction du risque urbain en périphérie nord-est de Cuzco (Pérou)
1. La construction du risque par une expa nsion urbaine
non maîtrisée
Avant le tremblement de terre de 1950, on comptait 216 hab./ha à Cuzco, ce qui représentait le
taux de densité le plus élevé au niveau national (Marco Cortez, 1989). Les demandes adressées
par les autorités locales à l’État afin de répondre à la surconcentration en ville par une politique
volontariste de construction sociale (viviendas sociales), restaient lettre morte.
Il fallut attendre le tremblement de terre de 1950 pour voir finalement la ville s’étendre au-delà
de son tracé colonial. Le bilan fut très lourd, transformant Cuzco en ville de barracas :
• sur un peu plus de 4 000 maisons, seul un quart ne fut pas détruit ;
• environ 35 000 personnes se retrouvèrent sans domicile. Vingt mille décidèrent de quitter
Cuzco, tandis que le reste des sinistrés s’installa à différents points de la ville avec leurs tentes
ou leurs maisons de fortune (barracas), sur les places, les avenues, les rues… (Marco Cortes,
1989).
La catastrophe eut au moins l’effet de pousser l’État à répondre enfin à la demande en
logement à Cuzco. Une loi d’imposition sur le tabac va financer la reconstruction de la ville,
et la participation internationale sera également conséquente. Le centre sera rénové, et la ville
plus moderne va prendre vraiment forme, avec une expansion urbaine orientée délibérément
vers l’est. La ville sera divisée en districts4, selon le Projet Pilote de 1952. La Réforme Agraire
favorisa involontairement la vente de nombreux terrains, tant et si bien que l’offre devint même
supérieure à la demande, certains propriétaires préférant se débarrasser de leurs vastes superficies
à bon prix pour échapper à cette orientation politique étatique les défavorisant :
« En 1962/1963, la Réforme Agraire a favorisé la vente de terrains dans la vallée, près
du Cuzco. Les propriétaires préféraient vendre leurs terres un bon prix à une compagnie
immobilière ou le lotir eux-mêmes plutôt que de risquer de se le voir enlever par
l’administration de la Réforme Agraire contre une indemnité qui serait moins importante »
(Durand, 1970 : 17).
Les classes moyennes furent d’abord intéressées par l’expropriation, menée sous l’égide de
l’État ; puis les classes plus pauvres purent se reloger de façon moins planifiée, principalement
à l’initiative privée des ordres religieux, de l’Assistance Publique5 et des grands propriétaires
terriens (hacendados), le long des pentes abruptes (laderas) :
« Après le tremblement de 1950, les problèmes urbains structurels s’amplifièrent. Près
de 90 % des logements en ville furent affectés par le séisme, ce qui provoqua le départ
d’un grand nombre d’habitants vers d’autres aires, aujourd’hui périphériques. La plus
grande déstructuration des espaces régionaux et la relation conflictuelle ville-campagne
toujours non résolue, qui voit Cuzco ne pas être articulée de façon indépendante à son
espace régional, surtout avec une absence de développement de l’industrie, furent une
des causes qui motivèrent et accélérèrent la crise urbaine.
La prolongation de l’avenida de la Cultura dans les années 1950 sera un premier pas
important dans l’implantation de quartiers vers le sud-est, qui s’accompagne d’un
phénomène connu sous le nom de conurbation de l’espace urbain (…), sur les aires
planes qui entourent la localité de San Sebastián. La majorité de ces terrains furent
expropriés par l’État, qui devint le promoteur en logement pour les classes moyennes
de la ville. La seconde pointe d’accroissement, dans les années 60, est caractérisée par
l’apparition de nouveaux acteurs sociaux non officiels, ceux-là même qui donnèrent
4 Les districts sont aujourd’hui au nombre de cinq : San Sebastián, Huanchac, Cuzco, Santiago, et San Jerónimo.
5 La Beneficiencia Pública fut fondée en 1790, et rétablie après les indépendances, en 1833. Elle hérita des biens
donnés aux hôpitaux de Cuzco à l’époque coloniale (Brisseau, 1981).
266
Nicolas Rey
lieu à l’extension de la ville clandestine, illégale et non planifiée (…) » (Quedena et al.,
1994 : 83-84).
L’obligation de trouver un terrain où se loger va amener la création de nombreuses associations
pour le logement (Asociacion Pro-Vivienda). La direction de chaque APV acheta de vastes
superficies, cette fois de façon collective, les terrains à lotir étant redistribués ensuite entre les
différents membres de l’association. De telles associations furent d’abord créées avec le souci
d’obtenir les services comme l’eau ou l’électricité dans un second temps en faisant pression
sur les pouvoirs publics. On va donc passer d’une occupation de terrains spontanée, à un type
d’organisation plus structurée, mais en générant toujours les mêmes problèmes, les services et
l’urbanisation échappant encore à toute planification :
« Les Associations sont régies par le Décret de Loi 13 500 promulgué en 1961. Elles sont
caractérisées par le fait que les associés acquièrent des terrains rustiques de la part de
l’État, des Églises ou des propriétaires particuliers. Mais comme les coopératives, elles ne
reçoivent pas l’appui de l’État, et le processus d’urbanisation est de leur responsabilité
directe (…) » (UNSAAC, 1986 : 28).
Malgré une plus grande coopération entre propriétaires (État, Églises, particuliers) et habitants
de ces zones qui achètent les terrains à travers la Asociacion Pro-Vivienda6, c’est donc toujours la
politique de l’« après-coup » de la part des autorités qui prévaut, avec son lot de dysfonctionnements
— discontinuité de la trame foncière, incohérence dans le système d’alimentation/évacuation des
eaux, etc. — affectant à terme l’ensemble de la ville :
« L’occupation précède l’assainissement, aux normes, des terrains. Ce sera la nécessité
de se doter des services de base et communaux qui, dans un second temps, amènera les
occupants de lots à se regrouper en Associations ou Unions de Propriétaires ou lotisseurs.
(…) Il apparaîtra également des problèmes liés à l’approbation de projets d’urbanisation :
alignement des voies, faute de superficies de réserve pour les voies publiques, absence
des 10 % pour les espaces verts, des 2 % pour l’État, etc. Les projets seront finalement
approuvés après la régularisation ou la restructuration » (Marco Cortez, 1989 : 9).
Après le tremblement de terre de 1950 et la colonisation des laderas, les glissements de terrain
vont affecter régulièrement la zone nord-est à partir des années 1980. Un type de risque en
amène t-il un autre ? Certes, mais les grands responsables restent les pouvoirs publics qui, par
faute de planification en direction des classes populaires, ont laissé les lotisseurs s’emparer des
pentes, construisant ainsi des zones à haut risque en dehors de tout contrôle. Dans le quartier
Los Incas, situé en périphérie nord-est de Cuzco, le long de pentes inclinées à plus de 30 %7, les
explications techniques le plus systématiquement avancées pour évoquer le risque urbain qui le
menace, sont les suivantes :
• les maisons à majorité en adobe offrent peu de résistance aux secousses sismiques toujours
systématiques dans la région (même si elles sont généralement de faible amplitude) ;
• la nature géologique des sols le long de ces pentes amplifie les ondes sismiques ;
• le système de drainage, tant en sous-sol qu’en surface, a été conçu en dehors de tout respect
des normes de construction établies par les pouvoirs publics.
Mais c’est plus l’expansion de la ville sans contrôle, que le seul caractère « dangereux » en soi du
site initial, qui a construit le risque à Cuzco :
« (…) ce n’est pas tant le site initial qui pose problème, mais l’expansion et la segmentation
du périmètre urbanisé qui s’accompagne des modifications des sites dangereux dans
l’espace et dans le temps au fur et à mesure du développement spatial de la ville, comme
6 D’autres dénominations vont s’imposer dans les années 1970 et 1980 pour qualifier ces quartiers dominant la ville :
les quartiers apparus sous la présidence de Velasco seront dénommés pueblos jovenes. Ils seront désignés ensuite
sous le terme de asentamientos humanos (établissements humains) dans les années 1980.
7 Le quartier est d’ailleurs traversé par une rue appelée à juste titre en quechua Anden Kawarina (« mirador des
Andes »).
267
La construction du risque urbain en périphérie nord-est de Cuzco (Pérou)
l’illustre l’expansion de Cuzco au Pérou dans un couloir intra-montagneux devenu trop
étroit » (Veyret, 2003 : 66).
C’est ainsi l’ensemble des habitants de la ville qui subit les conséquences d’une expansion
urbaine non maîtrisée depuis cinquante ans : la principale desserte longitudinale de la ville,
l’avenida de la Cultura, « coincée » dans une cuve montagneuse avec des voies secondaires
(transversales notamment) sans continuité, est régulièrement inondée, ce qui rend les secours en
cas de catastrophe extrêmement difficiles. Les quartiers de la zone moderne, pour les mêmes
raisons de problème d’évacuation des eaux, sont régulièrement affectés par les crues (Carreño,
1994 : 32).
2. Le raprochement fam ilial en périphérie, au « prix »
d’un risque plus grand
Dans les années 1960, les ordres religieux, franciscains et dominicains, vont s’avérer être les
principaux promoteurs fonciers dans l’expansion urbaine de Cuzco à l’est, le long des pentes. La
Asociacion Pro-Vivienda Los Incas va ainsi apparaître en 1963, sur des terrains qui appartenaient
aux Dominicains. Fortunato est un des premiers occupants, et le plus ancien encore présent dans
le quartier. Il nous raconte son installation à Los Incas :
« Los Incas a été fondé en 1963. Celui qui lotissait s’appelait Edgard Mostajo Sánchez,
il était avocat. Il vendait par lots, faisait des annonces à la radio. Aujourd’hui nous
sommes 650 familles à Los Incas. Nous avons nivelé par ici, c’était de la terre friable. J’ai
été le quatrième à m’installer ici. En 1962 j’ai rencontré ma femme, elle était de mon
village, Acumayo. Là-bas j’allais démarcher à Maldonado, en chargeant du verre pour
les travailleurs de l’or dans les mines… Pendant douze ans, en passant par le fleuve, les
montagnes ; deux jours de chemin, pour m’y rendre. En 1963, on s’est mariés, et on est
venus vivre ici. On a d’abord vécu à Huayrurupata, et les gens nous ont informé qu’il y
avait un quartier avec des terrains à acheter, parce que louer ça coûte. Il y en a de deux
cents, trois cents mètres carrés. Avec un ami, on a acheté ce lot, la moitié chacun, mais il
y a eu une dispute. Il voulait tout accaparer et me virer. Nous sommes allés voir Mostajo,
et il nous a divisé le terrain. Par la suite, je lui ai demandé de me connecter à son système
d’évacuation des eaux, mais il n’a pas voulu. J’ai dû faire ma propre connexion. Ensuite,
après que mes parents soient morts, ma sæur de Acumayo est venue dans l’année. Elle
m’a dit : ‘ Tu as déjà une maison, trouves-moi un terrain ’. Je suis allé demander pour
elle. Mon frère aussi, il a quitté Lima pour venir vivre ici, avec sa famille. Il est d’abord
venu vivre dans ma maison dans les années quatre-vingt, et après trois ans, je lui ai dit :
‘ tu ne peux pas rester là tout le temps. Tu dois te chercher un terrain ’. De là, il est parti
vivre à Garci Laso » (Fortunato, comité 6/ APV Los Incas, 31/03/04).
Garci Laso est un quartier contigu au comité 6 (Los Incas). D’un quartier à l’autre, les membres
d’une même famille se sont étendus, à l’image de Fortunato, de son frère et de sa « soeur » (il
s’agit en fait d’une cousine à lui), créant ainsi des réseaux sociaux favorisant la communication :
une porte, en effet, reliait les parcelles des deux frères entre Los Incas et Garci Laso. Lorsque
les glissements de terrain de 2001 et 2002 se sont produits dans le comité 6, ces « passages »
furent particulièrement mis à profit entre voisins et membres d’une même famille, situés sur
des parcelles contiguës. Mais par crainte de vols, ou de viol de leur intimité, les propriétaires
de ces passages préférèrent ensuite les fermer. Ainsi, la catastrophe peut dans un premier temps
resserrer les liens qui s’étaient construits sur plusieurs années, pour ensuite les défaire. Les
réseaux d’entraide mis en place à l’échelle de la parcelle entre les pionniers peuvent également,
après rupture, amener aussi à cette construction du risque, par la multiplication de connections
en alimentation/évacuation des eaux que cela implique, comme l’évoque Fortunato suite à
la division qu’il opéra avec son ami de la première heure à Los Incas. Ainsi, la catastrophe
est préparée bien avant qu’elle n’ait lieu, par la rupture de réseaux sociaux qui multiplie les
268
Nicolas Rey
incohérences sur le plan technique (connections au système d’alimentation/évacuation en eau).
Dans le même temps, la catastrophe peut rompre des réseaux d’entraide qui fonctionnaient
avant le désastre, depuis l’installation dans le quartier.
Comme les « pionniers » qui sont arrivés les premiers dans le quartier il y a quarante ans tel
Fortunato, aujourd’hui encore on quitte les localités plus rurales pour rejoindre les autres membres
de la famille, déjà installés en ville. Ce départ « s’organise » également comme autrefois : après
s’être marié, on part à deux s’installer en ville pour mieux l’affronter, pour y chercher le mieux
vivre et y fonder une famille. Les nouveaux venus sont alors dépendants du parent propriétaire de
la parcelle. Le témoignage ci-dessous de Jesusa est particulièrement instructif lorsqu’elle évoque
le contrôle social exercé sur elle par la famille de son mari chez qui elle est venue s’installer.
Cet informateur se livre à une comparaison avec son ancien quartier de résidence, Rosas Pata,
situé dans la ville plus formelle. Elle considère qu’elle avait plus de liberté « en ville » que dans le
quartier périphérique de Los Incas où la famille de son mari et les voisins surveillent ses moindres
faits et gestes. On a là un contrôle social qui va aller croissant de la part de sa belle-famille, en
fonction de ses installations successives à Cuzco dans différents quartiers :
« Je viens de Ollantaytambo, où mes parents et mes frères faisaient de l’agriculture. J’ai
vécu avec mon amoureux dès quatorze ans, et à seize je suis allée vivre à Huancaro, avec
mon époux. C’était un mauvais quartier. Il y avait de nombreux voleurs qui rentraient
dans les maisons, qui t’attendaient au tournant, te volaient tes vêtements. C’était comme
ça. Quand il pleuvait, il y avait de la boue partout. L’eau sale du fleuve rentrait dans les
maisons, les humidifiait, et après quelques années, elles tombaient.
Il y a huit ans, nous nous sommes installés à Rosas Pata. C’était mieux parce qu’il y avait
le marché à côté. La propriétaire était la tante de mon époux et elle nous faisait payer
moins cher. C’était pratiquement dans le centre de Cuzco, plus sûr, il n’y avait pas de
voleurs. La maison était plus grande qu’à Huancaro, il n’y avait plus de boue dans les
rues, c’était près des voitures. A Huancaro on avait une pièce, alors qu’à Rosas Pata
on avait une pièce et une autre plus petite pour la cuisine… c’était plus pratique pour
l’enfant, qui avait cinq ans, et plus prêt de l’école. Et mon époux était plus près de sa
famille, à Rosas Pata.
Puis on est passés à Los Incas, il y a cinq ans. Car ici on ne paie pas de location, c’est
la maison de ses parents. Ici nous avons trois pièces : une pour nous, une autre pour
le garçon de treize ans et la fille de neuf ans, et la cuisine. Dans toute la maison [la
parcelle], il y a trois familles en plus : mes belles-soeurs avec leurs époux et leurs enfants.
En venant m’installer ici, je l’ai très mal vécu, parce que ma belle-soeur est très méchante
avec moi, elle m’insulte : ‘ chèvre, chienne ’… Elle ne voulait pas que je sois avec son
frère. Elle voulait qu’il vive avec une amie à elle… Parfois quand il y a de l’eau, elle
ne me laisse pas en prendre. Comme mon mari n’est jamais là, il ne sait pas tout ça.
Également pour l’électricité, parce que eux ils l’utilisent plus avec tous leurs appareils :
ils ont un réfrigérateur, alors je ne veux pas payer la moitié de l’électricité avec ce qu’ils
utilisent… Je vivais plus tranquille à Rosas Pata, je sortais à n’importe quel moment, mais
ici, tout le monde t’observe, à quelle heure tu sors, ce que tu manges… » (Jesusa, comité
6/ APV Los Incas, 31/03/04).
Le parcours résidentiel de Jesusa est très instructif, car il fait apparaître comment chaque
installation auprès de la famille se fait en fonction de critères bien précis :
• chercher un plus grand confort, plus d’espace (on gagne une pièce à chaque déménagement)
au fur et à mesure que s’agrandit la famille ;
• ne plus avoir à payer de location.
Mais ce que l’on gagne en espace habitable et en économies, se paie au prix :
• d’un contrôle social plus fort exercé par la famille étendue, qui peut se traduire aussi par un
accès aux services sur la parcelle (eau, électricité) accaparé par les propriétaires de la parcelle,
au détriment des nouveaux venus ;
269
La construction du risque urbain en périphérie nord-est de Cuzco (Pérou)
• d’un risque urbain et d’une vulnérabilité subies au quotidien (violence urbaine, maisons
menaçant de s’écrouler, etc.).
Qu’est-ce qui pousse pour autant les habitants d’autres localités à rejoindre Cuzco ? La ville de
Cuzco reste au centre d’un réseau urbain au niveau départemental très structuré. Au niveau de
la province de Cuzco, l’accès aux services de base (eau, électricité) mais aussi l’alphabétisation
notamment des femmes, sont deux à trois fois supérieurs à la moyenne nationale, et devancent
de loin les autres provinces8. On quitte donc facilement les autres provinces du Pérou, mais aussi
l’intérieur de la province de Cuzco, pour rejoindre cette ville centre, plus attractive :
« Cuzco (…) s’est affirmée comme le centre politico-administratif et économique,
atteignant 24,2 % de la population totale départementale et 54,6 % de la population
urbaine départementale en 1993 (…). Cuzco : c’est le centre et l’intermédiaire de
presque toutes les dynamiques départementales. Sa hiérarchie politico-administrative,
ses fonctions commerciales et financières, ainsi que sa longue histoire d’articulation
aux niveaux régional et extrarégional, ont favorisé la concentration de services et l’ont
converti en un grand pôle attractif à tous les niveaux, au-delà de ses seules fonctions
marchandes. Cela a été renforcé par le flux aérien soutenu par le potentiel touristique
régional, et en relation avec Lima, avec le marché et le centre politico-administratif
national » (Hurtado & Puerta, 1995 : 11).
Mais une fois installés dans les périphéries, les nouveaux arrivants attirés par les lumières de la
ville, peuvent déchanter. En effet, les conditions d’accès aux services pour les plus pauvres, que ce
soit en périphérie de Cuzco ou dans le centre historique, ne sont pas meilleures que les chiffres
avancés à l’échelle nationale. D’après Riofrio (1996), les conditions de pauvreté et le manque de
services (eau), touchent autant les pauvres installés dans les constructions coloniales et modernes
du centre historique, que ceux ayant rejoint les zones à risque des périphéries, où les voies
carrossables manquent cruellement. On rejoint donc la famille pour avoir de plus faibles coûts en
logement et parfois plus d’espace, mais au prix d’un accès aux services limité et d’une exposition
au risque élevée. Comme le souligne D’Ercole (1991) pour la ville de Popayán, en Colombie — qui
connut un séisme à la suite duquel les pentes furent également comme pour Cuzco colonisées par
les exclus du logement social ou du secteur capitaliste — le risque social est bien plus obsédant
pour ces habitants, que le risque naturel. Et cet auteur d’ajouter (1991 : 452) que la vulnérabilité
« n’est pas seulement liée aux conditions économiques et sociales, mais aussi à la manière dont les
gens perçoivent le risque sismique ». Après enquête auprès d’habitants de Popayán9, le sentiment
de sécurité qui se dégage est « trompeur » et constitue un facteur de risque en cas de nouvelle
catastrophe ; en revanche cet optimisme n’est pas partagé par tous, notamment par les habitants
les plus modestes. Si ces derniers dans leur quartier ne se sentent pas menacés, ils craignent dans
le même temps les conséquences d’une nouvelle catastrophe à Popayan. Mais les habitants des
zones qualifiées « à risque » ont aussi une représentation du risque qui est d’ordre stratégique ; ils
savent habilement en faire un élément de pression sur les autorités dans leur confrontation pour
l’occupation des rares zones disponibles : les secteurs en pente.
3. « Cult ure » du risque contre immobilisme des
autorités
Dans la partie basse du comité 6/APV Los Incas, la plus touchée par les glissements de terrains
successifs d’avril 2001 et janvier 2002, les enfants préfèrent emprunter les chemins de traverse
8 Selon les recensements nationaux de population et de logement de 1993 (INE), Cuzco s’élevait au premier rang
pour l’accès à l’eau, à l’électricité, et pour l’alphabétisation des femmes, avec des taux avoisinant les 90 %, contre
des moyennes nationales respectivement d’environ 45 %, 25 % et 65 %.
9 Réalisée par D’Ercole, avec l’appui du BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières), d’Ingeominas et du
Sena de Popayán. Presque tous les habitants enquêtés considèrent que la ville est mieux préparée à affronter un
nouveau séisme, pour des raisons essentiellement techniques (maisons reconstruites, réparées et consolidées).
270
Nicolas Rey
entre les pans de murs effondrés et les tuyauteries éventrées, plutôt
que de suivre les circuits tracés autour du vide laissé par la partie
écroulée. Ils « jouent » à se faire peur, en repoussant les limites du
danger. Mais est-ce uniquement, un jeu d’enfant ?
Durant ces événements, les habitants sont restés jusqu’au dernier
moment dans leurs maisons : lorsque les murs ont commencé à
s’effriter et à se lézarder, et que les vitres se sont fendillées, ils ont
enfin décidé d’évacuer leur logement. Par la suite, ils sont revenus
s’installer dans leur maison éventrée, en se plaçant en retrait des
pièces situées en équilibre instable au-dessus du vide. Pour eux, il
est hors de question de quitter le seul bien qu’ils possèdent, leur
maison, fut-ce jusqu’au dernier moment… Le fait de vivre dans un
lieu constamment menacé, et souvent affecté par la catastrophe,
peut aussi amener une accoutumance, qui se traduit par une réponse
de moins en moins efficace pour faire face au désastre, avant, ou
pendant qu’il se produit :
« L’évaluation postcatastrophique est sans doute un des moyens les
plus efficaces pour comprendre le passage du risque à la catastrophe,
et donc proposer des mesures de prévention. (…) ce sont les études
postcatastrophe qui ont révélé les lois concernant l’accoutumance au
danger ; ces rapports montrent aussi la perte de mémoire classiquement
observée des usagers et des décideurs. Voici ce qu’écrivait en 1890 un
officier de l’instruction publique, Henry Vaschalde, à propos des crues
et inondations en Languedoc : ‘ Plusieurs années se passent sans qu’il
y ait de crues ; la confiance revient ; les maux passés sont oubliés, et
chacun s’empare du domaine des eaux jusqu’à ce qu’une inondation
comme celle du 22 septembre vienne détruire tous les travaux exécutés ’ » (Dauphiné,
2001 : 252-253).
Mais peut-on mettre en cause uniquement l’inconscience, ou la perte de mémoire ? Dans
des conditions extrêmes d’existence, les habitants vivent au jour le jour, sans avoir toujours
le luxe de pouvoir se projeter dans l’avenir. Dans les villes des pays en développement, que
ce soit le long des pentes abruptes, ou près des cours d’eau comme à Lima (cf. exemple cidessous),
le désastre rend les pauvres encore plus pauvres au quotidien (Maskrey, 1989) : les
habitants ressortent encore plus vulnérables d’une première catastrophe, cette vulnérabilité en
augmentation préparant les conditions d’un deuxième désastre, pouvant alors être plus ample.
Catastrophe après catastrophe, les habitants sont donc de plus en plus vulnérables et exposés à
de nouveaux désastres :
« Les inondations (…) affectent principalement les familles à bas revenus, qui ont les
capacités de réponse les plus faibles et dont les conditions de vie sont celles d’un état
d’urgence permanent, caractérisé par le manque d’eau potable, un habitat précaire et
des revenus bas et instables. Dans ces cas là, les effets des (…) inondations ne sont qu’un
aspect d’un désastre quotidien et permanent. Les catastrophes dans la vallée du Rímac
représentent une dégradation continue de la vie de la population. La destruction de
leurs maisons, la perte de leurs biens et l’interruption de leurs activités économiques
augmente leur vulnérabilité. Sans la possibilité de retrouver de nouvelles zones sécurisées
pour vivre, les gens reviennent occuper les secteurs dangereux » (Medina, 1994 : 273).
Si le désastre est social, la pauvreté en est le facteur le plus agissant. Et plus on est pauvre, plus
la catastrophe annoncée sera amplifiée. En 2003, dans le cas du quartier Chocco, en périphérie
sud-est de Cuzco, certains habitants qui avaient disposé leurs maisons au milieu du lit naturel
d’écoulement du fleuve, ne purent réagir rapidement pour s’échapper lors de la soudaine
montée des eaux. Le coût humain n’est jamais considéré par ces occupants de l’extrême, car
nous sommes dans une dynamique de survie au jour le jour, empêchant de se projeter bien loin
Figure 4 – Zone sinistrée du quartier Los
Incas. Une fillette « joue » avec le risque,
à l’entrée de ce qu’il reste de la maison
familiale suite aux glissements de terrain
de 2001 et 2002 (photo : Rey)
271
La construction du risque urbain en périphérie nord-est de Cuzco (Pérou)
dans l’avenir (un toit et manger chaque jour sont les seules prérogatives qui font force de loi). Il
faut aussi bien prendre en compte le fait que les derniers migrants, arrivés récemment dans ces
zones, sont aussi les moins avertis face aux catastrophes, et ce, pour deux raisons :
• tout d’abord, ils s’installent là où il y a encore de la place, donc le plus souvent, dans les zones
les plus ingrates, et les plus dangereuses, qu’on leur réserve (la communauté préfère en effet
se garder les terrains mieux situés, pas forcément les plus chers) ;
• la seconde raison est qu’ils n’ont pas encore pu mesurer la temporalité et l’intensité des
catastrophes potentielles. Cette information peut d’ailleurs ne pas être divulguée par les
responsables communautaires, au moment de la vente. Ainsi, à Chocco, un migrant arrivé en
2003 acheta son terrain près du fleuve traversant le quartier, sans se douter de la gravité du
danger qui le menaçait. Dans l’année de son achat, sa maison et ses biens furent emportés par
les crues.
Aujourd’hui, à Los Incas, trois maisons sont en équilibre instable au-dessus du vide. Parmi ces
occupants, deux familles ont acheté leur maison il n’y a pas plus d’une dizaine d’années : les
derniers arrivés, pas forcément les plus pauvres, sont en tout cas les plus mal lotis face au risque.
Le temps de l’expérience et les réseaux d’information sont donc des données fondamentales à
considérer dans la construction du risque. Comment les habitants de ces secteurs les plus touchés
par les glissements de terrain en 2001 et 2002, et menaçant de s’effondrer à tout moment, ont-ils
vécu la catastrophe, et pourquoi reviennent-ils s’installer là ? Julio, un de ces habitants en sursis,
nous relate les événements du 24 janvier 2002, qui ont affecté son foyer :
« Je ne peux pas partir, car mes enfants vont au collège à côté, donc pour le transport, je
préfère rester ici. La moitié de ma maison est fendue. La fissure n’a pas progressé après
l’effondrement. La porte ne se ferme pas bien. Mais ici, le problème c’est l’eau. Si on me
reloge avec l’eau là-bas, moi je partirai. Les autres à côté, ils ne veulent pas partir. Mais
moi je ne peux plus vivre là, la maison glisse, il peut y avoir un tremblement de terre. En
fait, il y avait un tuyau sous la terre qui s’est cassé, donc on voyait juste la sortie d’eau en
surface mais on ne voyait rien en dessous. Si on avait réglé ça… ça fait cinq ans que par
en dessous ça travaillait, et pire lorsque la pluie est arrivée : ça s’est mélangé avec cette
poche d’eau d’en dessous. On s’est rendu compte de ça après le glissement de terrain.
Pour l’éboulement de 2002, c’était dix heures du soir, le vingt-quatre janvier. Mais un
jour avant j’avais déjà remarqué que le chemin était fissuré, et la nuit, tout un bloc est
parti. C’était l’anniversaire de ma fille ce jour là, pour ses vingt ans. Elle était venue fêter
son anniversaire avec son mari. Finalement, elle est restée trois jours, car la situation était
désespérante. On était dans l’expectative, si quelque chose se passait, prêts à courir.
L’éboulement, ça a fait comme un volcan, les pierres, le bloc avec les escaliers… Les gens
situés plus bas, à Los Portales, sont sortis en hurlant lorsque toute cette masse a défoncé
leur mur. Les plus petits chez moi dormaient, les plus grands étaient en train d’observer.
On avait prévu de sortir par derrière par les escaliers, pour aller chez le voisin : par là
on a sorti nos affaires, le lendemain [de la catastrophe]. Le lendemain, la police nous a
dit à tous qu’il fallait libérer les lieux et se transférer ailleurs. Un de mes fils est revenu
s’installer dans la maison pour la surveiller, il ne voulait pas rester dans la maison louée
plus haut. ‘ Ah si elle tombe, qu’elle tombe ’, il disait… » (Julio, comité 6/ APV Los Incas,
09/03/04).
L’analyse du témoignage de Julio révèle plusieurs choses. Le statut de résidence principale, la
présence sur place, et l’ancienneté de la propriété, sont mis en avant pour bénéficier d’une
intervention extérieure afin d’être relogé. À cela vient se superposer le fait que les voisins immédiats
de Julio déclarent ouvertement qu’ils ne veulent pas être relogés ailleurs… Julio cherche donc
ostensiblement à se démarquer d’eux, en remettant en cause les revendications de ses voisins
qui, ayant racheté à sa famille leur terrain et leur maison, ne sont pas en mesure légitimement
selon lui d’imposer leur point de vue, au nom de tous. Il y a donc une différenciation sociospatiale
très forte, au sein même du secteur touché par la catastrophe, qui détermine l’attitude
de chacun, face au risque.
272
Nicolas Rey
Les rares interventions des habitants pour réduire le risque, peuvent même prêter à sourire :
on dispose des planches sans les fixer, contre le mur du voisin situé plus haut, prêt à tomber...
Il n’y a donc pas de réelle prévention du risque, mais plutôt une gestion dans l’urgence : la
mitigation (réduction du risque) durable serait-elle absente des consciences ? Il semble que les
habitants soient tout à fait conscients du risque qu’ils encourent. Leur « inaction » ne traduit pas
une inconscience avérée ; au contraire, elle est une stratégie visant à faire réagir les autorités. Le
manque d’attention que portèrent les hommes envers la Pacha Mama, la Terre Mère, lorsqu’ils
urbanisèrent les quartiers périphériques, est également une explication avancée par certains
habitants du quartier Los Incas, concernant les glissements de terrain qui se sont succédés. Le
terme pachakuti, traduit aussi par « retour de la terre » à travers ces glissements de terrain, est alors
évoqué, comme une réaction de la Pacha Mama… En Bolivie, ces termes ne sont plus connus de
la population indienne. Ils seraient cependant réinvestis par les leaders communautaires et/ou
des anthropologues développant un discours indigéniste, notamment en milieu urbain :
« Dans la société aymara, le juicio marque la fin d’un cycle et le début d’un autre. Ce
bouleversement qui verra l’apparition d’une nouvelle humanité est interprété comme une
inversion entre le monde du haut et le monde du bas (Harris, 1989), idée exprimée dans
les documents anciens par le terme pachakuti, aujourd’hui inconnu des paysans rencontrés
mais repris depuis peu dans les discours indianistes urbains » (Rivière, 1996 : 93).
Cette culture du risque semble avoir un objectif sous-jacent, et elle représente l’ultime issue pour
les habitants, afin de faire pression sur les autorités : tout est fait comme s’il fallait en rajouter un
peu plus à une situation déjà extrême, pour attirer l’attention de façon directe et sans détours, sur
les conditions de vie « invivables » de ces habitants. Dire qu’ils en jouent n’est pas un vain mot.
Lorsque les mères balancent leurs enfants de cinq ans à bout de bras au-dessus du vide, en les
faisant pleurer, peut-être est-ce pour leur apprendre à dompter la peur de leur condition, pour
mieux y faire face, ou encore pour m’interpeller, moi l’étranger, représentant à leurs yeux des
ONG et autres organismes internationaux, capables d’intervenir sur ces secteurs ?… Les premiers
mots qui me furent adressés par certains de ces habitants furent d’ailleurs : « vous voulez parler
avec nous pour quoi faire, pour nous aider ? »
De plus, les enfants montent les échelles reposant sans y être fixées sur des planchers flottant au-dessus
du vide, sans armatures les reliant à la pente ; ils sont envoyés également plus bas par les parents
qui les ignorent alors ostensiblement du regard, pour ramasser les ustensiles — seaux, vaisselle, linge
— tombés dans la pente, dans des endroits inaccessibles… un faux pas, et c’est la chute dans le
précipice formé par l’effondrement de l’escalier qui se trouvait là, avant la catastrophe.
Enfin, aucun escalier de rechange, même de fortune, n’a été reconstruit par ces habitants, qui
chaque matin, chaque midi, chaque soir, font le va-et-vient entre chez eux et l’extérieur, au péril
de leur vie…
Qu’attendent-ils d’ailleurs, au juste ? Avril 2001, avril 2004… après maintenant trois ans qu’a eu
lieu le premier drame, et autant de temps de promesses non tenues par les autorités, que peuvent
encore espérer les habitants comme amélioration de leur condition au quotidien ? « Après les
pluies, nous commencerons les travaux », leur répètent les autorités, comme un leitmotiv. Les
élections passent, et aux promesses électorales succède l’inaction, après le résultat des urnes. Les
autorités intervenant sur la zone sont toutes d’accord pour l’évacuer, mais chacune apporte une
réponse différente au problème posé.
La municipalité de Cuzco et le Ministère du Travail sont associés à travers le projet a trabajar
urbano qui consiste dans la zone nord-est de la ville à consolider la zone, avec la construction à
Los Incas d’un mur de contention qui est systématiquement reportée. Les dissensions politiques
entre le gouvernement et la mairie sont d’ailleurs souvent avancées par ces deux acteurs pour
justifier l’absence de prise de décision10. Chacun se renvoie donc la balle, et pendant ce temps,
10 Le premier des deux acteurs (le Ministère du Travail), « tolediste », du parti du président de la république de
l’époque, accusant le second (la municipalité de Cuzco) — et vice-versa — d’être affilié à l’autre bord politique,
celui de Fujimori (ancien chef de l’État péruvien).
273
La construction du risque urbain en périphérie nord-est de Cuzco (Pérou)
les lignes budgétaires tant au niveau de la municipalité, que du gouvernement, ont été utilisées
à d’autres fins. En 2004, le Ministère du Travail a pris prétexte des fortes pluies qui ont affecté le
sud du Pérou pour justifier à nouveau du report des travaux sur Los Incas.
Pour la Défense Civile décentralisée (région de Cuzco), la zone doit être évacuée. Ses ingénieurs
déclarent cependant qu’une fois la zone consolidée par le projet a trabajar urbano, certains
habitants seront alors convaincus que la zone aura été débarrassée de tout risque possible.
On constate donc que la politique de décentralisation menée par l’État rencontre des
contradictions très fortes au niveau local, entre les décisions prises par ses services au niveau local
(Defensa Civil de Cuzco), la municipalité, et les ministères. La décentralisation fut même, sous
Fujimori, mise au service « du chef », déstructurant l’action collective et rendant les structures de
quartier encore un peu plus dépendantes :
« Dès son arrivée à la présidence, A. Fujimori institue une extrême personnalisation du
pouvoir. Les fréquentes visites qu’il effectue dans les barriadas en témoignent. Cette
personnalisation du pouvoir, qui se manifeste par l’instauration de relations directes et
clientélistes avec les pobladores, s’observe dans plusieurs domaines. En premier lieu,
l’organisation administrative que le chef de l’État institue, et dont l’exemple le plus
significatif est le ministère de la Présidence. Ensuite, la politique de démantèlement des
structures d’action collective avec l’exemple du programme du verre de lait. (…) Au
début des années 1990, l’obtention d’un service collectif, par exemple au bureau de la
voirie, exige des démarches précises : soixante familles au minimum, et appartenant au
même district, doivent se réunir afin de présenter leur revendication et de solliciter un
crédit. Cette demande s’adresse au ministère de la Présidence, qui finance directement
le projet. Ainsi, le poblador peut associer directement la construction d’une infrastructure
à l’image du président » (Burgos, 2000 : 108-109).
Conclusion
Comme développé dans cet article, l’absence de volontarisme politique dans le domaine
de la planification urbaine depuis le tremblement de terre de 1950 à Cuzco, ou le caractère
contradictoire de certaines décisions prises par les autorités suite aux glissements de terrains se
succédant depuis les années 1980 en périphérie nord-est de la ville, sont générateurs pour les
habitants d’augmentation et du risque, et de la vulnérabilité. Dans le même temps, devant cette
défection des pouvoirs publics, les habitants se sont rassemblés en associations pour organiser
leur logement, avec de faibles moyens. Ils sont tombés dans le marché de la ville illégale, en
s’installant dans les seules zones disponibles, à savoir les plus dangereuses (le long des pentes
abruptes ou des courants d’eau en crue dès la période des pluies), sans respect des normes de
construction en matière d’alignement de voirie, de système de drainage, ou de résistance des
matériaux dans une région à forte activité sismique. Une véritable « culture » du risque va alors
se développer, mêlant à la fois au premier abord résignation face à un destin qui s’acharne, voire
attitude de trompe-la-mort, comme pour provoquer un peu plus la providence, ou encore retour
à des croyances se réclamant du passé incaïque. En effet, face à l’action des hommes « modernes »
pris dans le modèle urbain occidental dominant, la Terre (la Pacha mama) et les ancêtres incas
morts pour préserver ce territoire contre l’expansion coloniale espagnole, se vengeraient, en
réagissant de façon violente à travers les catastrophes frappant la ville (crues, glissements de
terrain). Peut-on se contenter cependant d’une explication de type fonctionnaliste ou culturaliste
pour appréhender dans sa complexité la construction du risque dans cette ville andine ?
De plus, l’après catastrophe sans union pour faire face aux problèmes quotidiens qui affectent
tous les habitants (le quartier n’en finit pas de s’affaisser après les glissements de terrain survenus),
et l’abandon de l’action collective pour se replier sur la famille, sont propices à une augmentation
sensible de la vulnérabilité de chacun. Cette vulnérabilité s’est accentuée suite au détournement
par certains représentants de quartier de fonds alloués par les habitants pour les travaux d’ordre
274
Nicolas Rey
général. Le « pourrissement » de la situation est ainsi renforcé, plongeant un peu plus le secteur
effondré, vers une nouvelle catastrophe. Les habitants seraient-ils à ce point inconscients en
laissant leur quartier tomber en ruine ?
Sur le terrain du quartier Los Incas, lorsque l’espoir s’est encore un peu plus éloigné en avril
2004 de voir s’améliorer la situation par une intervention des pouvoirs publics sur la partie
affectée (glissements de terrain de 2001 et 2002), on peut observer qu’individuellement,
certains habitants sont intervenus alors eux-mêmes pour prendre enfin en charge un minimum
de travaux d’amélioration. Après que les habitants aient été informés du nouveau report du
projet de consolidation de leur secteur effondré, certains parmi les plus menacés ont amorcé des
travaux d’amélioration :
• les uns ont fermé avec des planches le terrassement qui marquait l’entrée de leur maison, où
les enfants jouaient, au-dessus du vide ;
• les autres ont creusé dans la pente quelques marches, permettant ainsi de remonter dans les
maisons en équilibre instable, en limitant les risques de faire une mauvaise chute.
L’inaction des habitants n’était donc qu’un leurre, destiné à faire pression sur les autorités…ou
comment l’inaction est, de fait, action ! Dire que les habitants de ces quartiers ne sont pas
conscients du risque qu’ils encourent, c’est faire totalement fausse route, sans voir les stratégies
cachées mais inhérentes, à leur attitude, jugée par d’aucuns, passive. Quant à la prévention, ce
n’est pas à eux, mais aux autorités, de l’assumer. Il y a en réalité une conscience très aiguë du
risque chez les habitants, et leur inaction de façade amenant un pourrissement de la situation
(maisons qui tombent en ruine) est de fait, après analyse et recontextualisation, une action des
plus volontaristes qu’il soit, pour précisément amener les autorités à prendre leurs responsabilités,
à terme. Et si l’on peut sortir de la situation de confrontation entre pouvoirs publics et autorités,
peut-être sera-t-il alors temps d’envisager le rapatriement des pratiques préventives populaires
acquises au fil du temps par les habitants, vers les secteurs décisionnels :
« De tout temps, des systèmes d’entraide communautaire plus ou moins institutionnalisés,
tel que le gotong royong dans les kampungs de Djakarta, ont permis d’éviter bien des
victimes dans des incendies ou des inondations. Cette réalité sociale apparaît comme
un élément très positif à partir duquel les autorités publiques sont tentées d’utiliser ces
réseaux traditionnels pour ‘ apprivoiser le risque ’. L’idée est d’informer et d’accoutumer
les populations au risque et de créer de ‘ bons ’ réflexes. (…) Il a souvent été remarqué
que la pauvreté, la densité, les problèmes spécifiques liés à la gestion et l’absence
d’accès à certains outils techniques accentuent la vulnérabilité des villes du sud, alors
que peut-être, à l’inverse, ces dernières possèderaient une spécificité en matière de
réponse sociale à la crise (…) » (Milbert, 2003 : 325).
Pour l’heure, le risque demeure un enjeu politique entre habitants et autorités, construit avant,
pendant et après la catastrophe. « Action » et « inaction » sont donc à recontextualiser de façon
très précise, en fonction des enjeux et intérêts sous-jacents voyant s’opposer les différents
acteurs intervenant sur la zone sinistrée. D’un côté, la démarche de l’anthropologue vise alors
à comprendre comment le « traditionnel » est instrumentalisé par les habitants, pour amener
les autorités à réduire le risque. La culture du risque en étant étudiée en fonction du système
de croyance propre aux sociétés andines, ne doit donc pas tomber dans le piège de l’assessorat
ethnique. De l’autre, il s’agit de percevoir comment le risque naturel peut être instrumentalisé
par les autorités, afin d’entretenir une dépendance entre administrés et leurs représentants.
Cette dépendance repose sur une politique de l’urgence : on n’intervient qu’après-coup, une
fois la catastrophe passée. La vulnérabilité des habitants est telle qu’ils ne peuvent refuser tout
type d’aide, aussi minime soit-elle, afin de panser les plaies du désastre. Cette relation clientéliste
entre habitants et élus, construite durant les décennies d’installation le long des laderas, est
finalement consolidée une fois la catastrophe réalisée : culture du risque chez les habitants contre
immobilisme par l’action contradictoire des autorités, ne font que perpétuer un tel système.
275
La construction du risque urbain en périphérie nord-est de Cuzco (Pérou)
Si l’on souhaite appréhender au plus près ces enjeux qui opposent habitants et autorités,
entre représentation du risque dans les secteurs menacés et intervention des pouvoirs publics
dans l’espace urbain et péri-urbain, le recours à une approche de type socio-spatiale, offre
des outils d’analyse permettant de mieux cerner la construction du risque dans sa complexité.
L’approche sociologique, développée brillamment depuis les années 1980 par les chercheurs du
réseau latino-américain La Red, emmenés notamment par Maskrey, a évolué récemment vers
une méthodologie de type microsociologique ou anthropologique, avec la constitution d’une
véritable anthropologie des catastrophes, notamment à travers les travaux d’Oliver-Smith (2002)
ou encore de Stein (2002). Et les recherches menées par les géographes français dans les années
1990 (D’Ercole, Thouret, Chardon, etc.), ont eu le mérite d’articuler l’approche spatiale avec
celle plus sociale, du risque. Reste à la recherche sur le système risque de mobiliser davantage
les chercheurs européens, nord ou sud-américains, pour éviter qu’ils ne rejoignent le champ de
leurs recherches de prédilection (Lavell, 1993), après les grandes catastrophes11.
Références citées
Briseau , J., 1981 – Le Cuzco dans sa région : étude de l’aire d’influence d’une ville andine, 571
p. ; Lima : Intitut Français d’Études Andines. Série Travaux de l’IFEA, 16.
Burgos, D., 2000 – Villa El Salvador : un bilan de la participation politique. Problèmes
d’Amérique latine, n° 38 : 101-116.
Careño, C., 1994 – Risques naturels et développement urbain dans la ville andine de Cuzco,
Pérou. Revue de Géographie Alpine, n° 4, Tome LXXI : 27-45.
Centro Bartolomé de Las Casas, 2003 – Gobernancia y riesgos ambientales urbanos en Cusco ;
Cusco.
Chardon, A.-C. & Thouret, J.-C., 1994 – Cartographie d’une vulnérabilité de la population
citadine face aux risque naturels : le cas de Manizales. Mappemonde, 4 : 37-40 ;
Montpellier.
D’Ercole, R., 1991 – Vulnérabilité des populations face au risque volcanique, le cas de la
région du volcan Cotopaxi (Équateur). Thèse de doctorat ; Grenoble : Université Joseph
Fourier.
Dauphiné , A., 2001 – Risques et catastrophes. Observer, spatialiser, comprendre, gérer, 288 p. ;
Paris : Armand Colin.
Durand, G., 1970 – La banlieue est du Cuzco et son expansion contemporaine. Mémoire de
maîtrise de Géographie ; Paris : Université de Paris 8.
Hurtado , I. & Puerta , M., 1995 – Las tendencias del crecimiento urbano en el departamento
de Cusco. Crónicas Urbanas, 4: 5-16 ; Cusco : Crónicas urbanas.
Lavell , A., 1993 – Ciencias sociales y desastres naturales en América latina: un encuentro
inconcluso. In: Los desastres no son naturales (A. Maskrey, ed.) : 135-154 ; Bogotá: La red
de estudios sociales en prevención de desastres en Amérique Latina, La Red-Tecnología
intermedia. ITDG.
Marco Cortez, A., 1989 – La historia que no fue contada. ¿Quiénes le dieron al Cusco la
forma que ahora tiene ? Crónicas Urbanas, 1: 4-12 ; Cusco : Crónicas urbanas.
11 Cf. les tremblements de terre de Mexico, San Salvador, Guatemala, ou la catastrophe du Nevado de Ruiz, qui ont
mobilisé la communauté scientifique internationale (Colombie).
276
Nicolas Rey
Maskrey, A., 1989 – El manejo popular de los desastres naturales : estudios de vulnerabilidad
y mitigación, 208 p. ; Lima : ITDG.
Medina, J., 1994 – Experiencias de mitigación de desastres. In : Viviendo en riesgo : comunidades
vulnerables y prevención de desastres en América Latina (A. Lavell, ed.) : 267-282 ;
Bogotá: Facultad latinoamericana de ciencias sociales-FLACSO, Red de estudios sociales
en prevención de desastres en América Latina, La Red-Centro de prevención de desastres
naturales en Centro América. CEPREDENAC.
Milbert, I., 2003 – Vulnérabilité et résilience des métropoles : « elles sont si fragiles ». In :
Développement durable et aménagement du territoire (A. Da Cunha, ed.) : 313-
330 ; Lausanne : Presses Polytechniques et Universitaires Romandes.
Oliver-Smith, A., 2002 – Catastrophe and culture: the anthropology of disaster, 312 p. ; Santa
Fe: School of American Research Press.
Pirotte , C., Huson, B. & Grünewald , F. (eds.), 2000 – Entre urgence et développement,
pratiques humanitaires en question, 237 p. ; Paris : Karthala.
Quedena, E., Estrada, E., Apa za, D., Paredes, P., Arteaga, Y. & Quiñonez, L., 1994 –
Los retos del desarrollo agro-urbano, el caso de San Jerónimo-Cusco, 208 p. ; Cusco :
Centro Guaman Poma de Ayala.
RIOFRIO, G., 1996 – Lima: Mega city and mega-problem. In : The Mega-City in Latin America
(Gilbert A., ed.) : 155-172 ; Tokyo : The United Nations University Press.
RiviÈre, G., 1997 – Bolivie : le pentecôtisme dans la société aymara des hauts-plateaux.
Problèmes d’Amérique latine, 24 : 81

saider- Je Suis Un Membre Actif
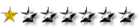
-
 Messages : 69
Messages : 69
Points : 156
Réputation : 5
Age : 59
Localisation : arch
Emploi/loisirs : architecte
chahra-
 Messages : 684
Messages : 684
Points : 701
Réputation : 6
Age : 51
Localisation : Alger
Emploi/loisirs : Architecte
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum|
|
|

 Accueil
Accueil
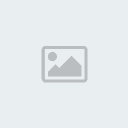
» Jeux de lumières
» MEMOIRE TECHNIQUE
» Pourquoi s’installer en périurbain ?
» urgent !!!!!!!!!!inscription plateforme en ligne du doctora
» exempls de Memoires M2 pour systeme classique intégré EN M2
» Besoin de la carte d'état major de la ville Blida en fichier numérique
» sujet concours de doctorat
» master2 annaba
» service 3d
» PUD de la ville d'ORAN
» Les cours Projet urbain CVP
» urgent !!!!